Le texte suivant est issu de l’ouvrage 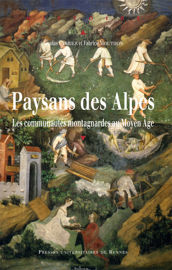
On y trouve des références sur Léoncel
Les transformations des xie-xive siècles ont abouti à façonner le peuplement et les paysages alpins tels qu’ils ont existé pour l’essentiel jusqu’à la fin du xixe siècle, moyennant les changements apportés à l’époque moderne par l’essor de l’élevage commercial, l’introduction de la pomme de terre et les prémices du tourisme alpin. On peut vraiment parler d’une conquête de la montagne durant les trois siècles du Moyen Âge central, car au terme de cette période, les hommes dominent un environnement qui, jusqu’alors, les tolérait simplement. Certes, les montagnards du Moyen Âge se soucient peu de conquérir les pics et les glaciers, qui les inquiètent plus qu’ils ne les attirent. Mais ils se soumettent progressivement toute la montagne utile, c’est-à-dire celle qui peut les nourrir.
Moines, seigneurs et paysans
2Ce que l’historien constate en premier lieu, c’est une impressionnante mutation documentaire : entre le xie siècle au plus tôt et le xiiie au plus tard, les hautes vallées alpines sortent de l’obscurité où, sauf exception, elles étaient confinées depuis toujours. Désormais, des textes de plus en plus nombreux les concernent en propre, et non comme faisant partie d’ensembles plus vastes ; désormais, elles ne sont plus seulement mentionnées, mais encore décrites ; désormais, elles apparaissent comme cadre d’une vie locale active, et pas seulement comme voies de passage et enjeux stratégiques. Globalement, la lumière vient du sud : les Alpes méridionales sont éclairées les premières. En fait, les vallées et les massifs qui bénéficient de la documentation la plus ancienne sont ceux qui ont été englobés, en tout ou en partie, dans un patrimoine monastique. C’est une situation documentaire assez commune en Europe occidentale : avant les premiers progrès de l’État moderne, seule l’Église produit et conserve systématiquement des archives, en sorte que son patrimoine et son action se trouvent spécialement éclairés. C’est particulièrement vrai des ordres monastiques, dont les chartriers et les cartulaires représentent en volume l’essentiel de nos sources pour l’histoire des temps dits féodaux.
Les Alpes éclairées par les archives monastiques
3Dans les Alpes, le rôle des moines dans la mise en valeur des hautes vallées alpines bénéficie donc jusqu’à la mi-xiiie siècle d’un éclairage documentaire quasi exclusif : toute activité économique qui ne les concerne pas au moins indirectement est laissée dans l’ombre. Il faut reconnaître que l’historiographie alpine ancienne s’est un peu laissé prendre à ce biais documentaire. Dans les massifs alpins, affirme-t-elle, les xie-xiiie siècles sont le temps des moines. Ils défrichent les alpages, inventent les techniques de l’estive et de la fabrication du fromage et, tout de même, peuplent les hautes vallées en faisant appel à la colonisation. Les xive et xve siècles, en revanche, sont le temps des paysans. Les ordres religieux sont alors en crise ; ils renoncent à exploiter leurs alpages en faire-valoir direct et permettent aux communautés rurales d’y accéder.
4Cette vision binaire a pour elle un fait avéré, qui est l’indéniable intérêt que de nombreux monastères ont précocement accordé à l’élevage et aux pâturages de montagne. En Suisse centrale par exemple, l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln, fondée en 934, a accordé immédiatement à l’exploitation pastorale une importance assez grande pour que les annales du monastère signalent une épizootie survenue en 9421. Au siècle suivant, ce sont les Alpes méridionales qui sont, de loin, le mieux illustrées par les sources monastiques. Ainsi des Préalpes lombardes et piémontaises2. Les religieux y acquièrent très tôt de vastes espaces pastoraux. C’est le cas par exemple du monastère Santa Eufemia, fondé en 1030 sur la bordure des Préalpes brescianes et doté dès l’origine d’abondantes prairies dans la vallée du Chiese. Au cours du xie siècle, il reçoit plusieurs alpages en Valcamonica et en Val Trompia.
5Néanmoins, ce qu’attestent les archives monastiques elles-mêmes, c’est que les religieux ne sont pas seuls sur les montagnes, il s’en faut de beaucoup. Tout au contraire, ils apparaissent comme acteurs parmi d’autres de la mise en valeur des Alpes, aux côtés des évêques, des seigneurs laïcs et des communautés paysannes. Avant que les religieux ne s’y installent, les vallées lombardes et les montagnes qui les entourent étaient d’anciennes curtes fiscales, c’est-à-dire de grands domaines qui, au haut Moyen Âge, appartenaient au roi d’Italie. Le fisc d’Almenno, par exemple, englobait l’intégralité de la Valle Imagna et la Val Brembana jusqu’à Zogno, avec les montagnes qui bordent ces vallées. Au xie siècle, lorsqu’elles sont soudain éclairées par la documentation, les curtes montagnardes sont logiquement aux mains des grands personnages laïcs ou ecclésiastiques qui exercent le pouvoir de ban au nom d’un roi peu présent. Ce sont notamment les évêques de Bergame et de Brescia, mais aussi de grands laïcs comme les Gislebertins, comtes de Bergame. Ces hauts personnages ne semblent guère exploiter directement les montagnes. Quand ils ne les ont pas déjà inféodées à leurs vassaux, ils en concèdent l’exploitation aux communautés rurales des hautes vallées, en échange d’un droit d’usage de l’herbe (herbaticum) et de la dîme des troupeaux. Ou encore ils en font aumône à des monastères. C’est donc une chose commune que de voir un alpage être d’abord terre fiscale, puis épiscopale, enfin monastique. L’alpage d’Otro, situé dans la Valsesia, vallée qui descend du Mont-Rose pour déboucher sur la plaine de Novare, est donné en 1025 par l’empereur Conrad II à l’église épiscopale de Novare. En 1083, l’évêque le cède à son tour au monastère clunisien de San Pietro di Castelleto. Pour cet établissement, situé dans le diocèse de Verceil, c’est le commencement d’une politique systématique d’acquisition de biens fonciers dans la vallée, qui durera plus d’un siècle. D’ailleurs ce qui est cédé aux communautés religieuses, ce sont des droits d’usage mais aussi des droits de seigneurie sur certains alpages qui, dès qu’ils apparaissent dans la documentation, paraissent divisés en associations de copropriétaires, ou consortages. Le chapitre de San Giulio, sur le lac d’Orta, détient des droits seigneuriaux sur l’alpage de Rondo, situé dans une vallée latérale à la Valsesia, le Val Mastellone. C’est dans les archives du chapitre qu’on voit en 1011 un prêtre d’une église de Gozzano, village au bord du lac, céder à un certain Jean deux parts de cet alpage. D’autres parts font l’objet de transactions en 1033 et en 1072.
6C’est ainsi que certaines des hautes vallées des Préalpes lombardes ou piémontaises donnent l’impression d’une exploitation relativement intensive dès le xie siècle. En 1018 déjà, et à nouveau en 1091, les habitants de Borno, en Valcamonica, sont en conflit avec ceux de Val di Scalve pour l’usage du Mont Negrino (alt. 2 000 m), qui dépend de l’évêque de Bergame, mais sur lequel pas moins de quatorze seigneurs laïcs ou établissements religieux prétendent détenir des droits. D’une manière générale, il semble bien qu’au xie siècle, des vallées lombardes relativement élevées, comme la Valseriana ou la Valcamonica, soient davantage mises en valeur que celles qui se trouvent au débouché des Alpes, comme la Valle San Martino, où marécages et forêts ne sont sérieusement attaqués qu’au xiie. C’est un constat qui s’impose en bien des massifs des Alpes occidentales : la montagne n’a pas été mise en valeur du bas vers le haut, et les hautes vallées ont souvent été exploitées les premières, certainement pour leurs potentialités pastorales.
Monastères et transhumance (xie-xiiie siècle)
7Là où le rôle des moines semble avoir été particulièrement important, sans exclusivité toutefois, c’est dans l’essor de la transhumance ovine dans les Alpes méditerranéennes. En effet, les communautés religieuses alpines et subalpines ont très fréquemment choisi l’élevage transhumant comme base économique privilégiée de leur projet spirituel. Partis pour chercher le royaume de Dieu, les religieux se sont fait donner par surcroît estives d’altitudes, prairies d’hivernage, droits de passage nécessaires pour relier les unes et les autres, et privilèges leur permettant d’écouler aux foires régionales les produits de leur activité. Les chartriers de très nombreux monastères témoignent de la volonté de constituer des ensembles fonciers adaptés à la transhumance.
8Ainsi dans les Alpes provençales. Vers la mi-xie siècle, un seigneur du nom de Rostaing Rainard donne à l’abbaye Saint-Pons de Nice un cent de brebis et surtout un considérable territoire désert situé en haute Vésubie, et incluant alpes et pâturages intermédiaires. C’est pour que le monastère y fasse paître ses juments et brebis de toutes provenances. L’abbaye en confie l’exploitation aux religieux de son prieuré de Saint-Dalmas-de-Valdeblore. Peu après, ce monastère reçoit du même Rostaing le tiers des « brebis seigneuriales » de Saint-Dalmas et, pour l’hivernage de ces dernières, le tiers du pâturage qu’il possède à Aspremont, village tout proche de Nice3. Ces textes témoignent que le seigneur donateur utilisait pour ses brebis un parcours que les moines n’ont fait que récupérer. Certaines communautés paysannes pratiquaient aussi la transhumance, comme en témoignent les plus anciennes archives des communautés de Tende, Saorge et La Brigue, dans l’arrière-pays niçois. Pourtant, il semble que l’arrivée des religieux sur les pâturages de montagne ait donné une ampleur nouvelle à la transhumance provençale. En Vésubie, les troupeaux des bénédictins de Saint-Pons sont bientôt rejoints par ceux d’autres établissements religieux, par exemple les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou le chapitre cathédral de Nice.
9Il en va de même en Dauphiné. La douzaine de monastères (dont neuf chartreuses) qui se sont installées dans les Préalpes dauphinoises entre la fin du xie siècle et celle du xiiie ont tous pratiqué la même politique4. Instituée en Vercors en 1137, l’abbaye cistercienne de Léoncel fonde par exemple huit granges grâce à diverses donations : cinq se trouvent dans les montagnes du Vercors, deux dans la plaine de Valence et une en basse Isère. Par « grange », on entend des exploitations agricoles, avec champs, moulins et vergers, mais aussi des centres pastoraux d’été ou d’hiver, autour desquels les cisterciens ont à cœur d’agrandir leur pré carré, par donations puis par achats. Non loin de Léoncel, est fondée sept ans plus tard la chartreuse de Bouvante. Entreprenant systématiquement d’acquérir les alpages qui bordent leur monastère, les chartreux entrent en conflit avec les cisterciens pour le contrôle de la montagne de La Saulce. Au terme d’une transaction pour laquelle la chartreuse a acquitté 600 sous viennois, le versant tourné vers Bouvante lui revient, tandis que les cisterciens gardent celui qui regarde Léoncel. Pour pourvoir à l’hivernage de son bétail, Bouvante fonde une grange en plaine, sur des pâturages donnés à Châteauneuf-d’Isère par les seigneurs de Beauregard, et ne manque pas d’acheter de quoi instituer des étapes intermédiaires. Surtout, en 1256 la chartreuse arrive à se faire concéder tous les pâturages de Montélier (Drôme) par l’évêque de Valence et les cinq coseigneurs du lieu, avec la faculté d’y faire paître 1 800 bêtes à laine, dix bœufs, quarante vaches, trente chevaux, d’y bâtir une grange et un four et d’y faucher 70 sétérées de pré.
10On conçoit que la liberté de passage entre pâturages d’hiver et d’été représente un enjeu vital pour les monastères. Ils n’ont eu de cesse de s’en faire concéder à titre d’aumônes par les seigneurs détenteurs des divers péages qui coupent les itinéraires pastoraux. En 1165 par exemple, Raymond V, comte de Toulouse et marquis de Provence, donne libre passage sur ses terres aux bêtes de Léoncel, avec exemption de redevances. En 1184, il accorde le même privilège aux troupeaux de la chartreuse dauphinoise de Durbon, dont les alpages se trouvent essentiellement dans les montagnes du Dévoluy, et les pâturages hivernaux, en Provence. Les chartreux de Durbon obtiennent également la gratuité du parcours et de la pâture sur les seigneuries des comtes de Forcalquier, d’Albon et de Valentinois, des sires de Sigotier et de Mévouillon. En 1218, le comte de Provence prend sous sa sauvegarde tous leurs troupeaux « allant et revenant par toute la Provence, où qu’ils stationnent ». Le passage n’est pas toujours gratuit : pour atteindre leurs pâturages de la plaine de Valence, les cisterciens de Léoncel empruntent la vallée de la Barbérolle, dans le mandement de Pellafol. Il leur en coûte à chaque passage un mouton levé au profit du sire de Pellafol, prélèvement remplacé par un cens annuel de trois sous viennois en 1294. Ce n’est pas cher payé, car en échange, leurs troupeaux peuvent stationner dans la vallée autant qu’il leur est nécessaire, et les pâtres couper tout le bois dont ils ont besoin. Sur le chemin de leurs pâturages provençaux, les troupeaux de Durbon sont amputés d’un mouton à l’aller et au retour, au profit du seigneur de Montrond, à moins que les moines ne préfèrent lui faire un cadeau. Le seigneur de Méreuil les accueille gratuitement, mais ils ne peuvent pas séjourner sur ses terres plus de cinq nuits.
11Enfin, les religieux ont eu également à cœur de prévoir l’écoulement des produits de leur activité pastorale, laine, cuirs, fromages et viande. Pour ne citer que deux exemples, les moines de Durbon ont ainsi obtenu une exemption de taxes sur les marchés d’Aix et de Marseille, et ceux de la Grande Chartreuse ont acquis le droit de commercer librement dans tout le diocèse de Lyon.
12Les statuts cartusiens de Guigues (xiie siècle) sont riches en renseignements sur l’organisation de l’exploitation pastorale par les chartreuses. Elle est placée, comme toute la vie économique, sous l’autorité du procureur, mais le soin du troupeau revient particulièrement à l’un des frères convers, le « maître des pâtres ». Sous sa direction travaillent d’autres convers, des « donnés » et des « mercenaires », qui ne sont pas des religieux mais de simples salariés. Dans les pâturages d’été, les chartreux ont bâti des édifices qui servent au repos des pâtres et à la confection du fromage, les « celles » ou « arcelles ». En hiver, le troupeau du monastère va per grangias,de granges en granges, consommer sa nourriture d’hiver. Les statuts autorisent chaque maison à posséder au maximum un troupeau de 1 200 brebis ou chèvres allaitantes et 60 vaches, sauf si le prieur de la chartreuse donne une dispense pour 1 800 brebis. Les agneaux auxquelles elles donnent naissance en été sont pour la plupart vendus à la redescente de l’alpe.
13Certains monastères subalpins ne se sont pas moins intéressés à l’élevage transhumant que ceux qui sont établis en montagne. C’est le cas, depuis le xiie siècle, de plusieurs établissements de la plaine piémontaise5. Les uns se trouvent au débouché des vallées alpines, comme l’abbaye cistercienne de Staffarda, qui exploite divers pâturages des Alpes cottiennes ; comme aussi l’abbaye bénédictine de Notre-Dame de Pignerol, qui fait monter ses troupeaux dans le Valcluson et la valléeGermanasca ; comme enfin la chartreuse de Monte-Benedetto, dont les moutons inalpent également dans le Valcluson, et aussi dans la haute vallée de la Doire Ripaire. D’autres monastères sont plus éloignés : les troupeaux de l’abbaye cistercienne de Casanova, établie aux alentours de Carmagnola, doivent franchir jusqu’à 100 km pour gagner leurs pâturages d’été situés dans le haut Valcluson et la vallée Germanasca ; bien longues également sont les distances que doivent franchir les bêtes des cisterciens de Lucedio qui, partant de la plaine de Verceil, inalpent sur les pâturages de la Vallée Étroite, aux alentours de Bardonnèche. Ces différents monastères ont obtenu de l’empereur, du comte de Savoie, du dauphin de Viennois, du marquis de Montferrat, de l’évêque de Turin et de quantité d’autres seigneurs piémontais et alpins une série de droits de pâtures, d’exemptions de péages et de sauvegardes qui leurs sont vitaux tant pour le parcours de leur bétail entre pâturages estivaux et hivernaux que pour le commerce de leurs produits. Car on voit les convers de Staffarda et de Casanova sur les marchés de Saluces, Bra, Verzulo, Alba, etc. Et les fromages fabriqués dans les celles des cisterciens de Casanova sont écoulés jusqu’en Ligurie.
14Ayant acquis assez facilement la liberté de circulation et de commerce entre les Alpes et le Golfe de Gênes, les religieux piémontais ont rencontré bien d’autres difficultés avec les communautés paysannes des autres vallées. L’abbaye de Casanova, par exemple, a réussi au début du xiiie siècle à acquérir l’alpe de Tête, en Valcluson, ainsi que des droits importants sur l’alpe de Pierrefixe et sur celle duPix, aux confins de la valléeGermanasca. En même temps, les cisterciens ont contracté avec une partie de la population autochtone. En 1225 par exemple, un couple de Pragelas donne la plus grande partie de ses biens à l’abbaye, bétail compris, en s’en réservant l’usufruit durant le temps de sa vie. En échange, les cisterciens hiverneront ce bétail en plaine, moyennant le versement de 10 sous par trentaine d’ovins et d’une partie de la laine récoltée. De la Saint-Jean à la Saint-Michel, les bêtes remontent en alpage et sont à nouveau confiées au couple. Celui-ci garde pendant l’hiver la maison du monastère à Pragelas. Cet accord ne doit pas masquer le conflit qui oppose durant tout le xiiie siècle les moines de Casanova aux communautés rurales d’Oulx et Césanne pour l’exploitation des alpages du Pix, de Tête et de Pierrefixe. Conflit qui se conclut à la fin du xiiie siècle par un compromis favorable aux cisterciens : les paysans doivent redescendre leurs bêtes quand les moines inalpent les leurs, et seuls ceux qui possèdent des prés de fauche à Pix et à Pierrefixe peuvent les remonter au mois d’août, quand ils y font les foins6.
Les premières confrontations entre monastères et communautés rurales
15Nombreux sont les conflits entre les monastères désireux de faire fructifier les droits de pâture qu’ils ont acquis en montagne et les communautés paysannes installées sur place. Ils sont souvent dus à l’ambiguïté des donations concédées aux établissements religieux, elle-même explicable par le statut particulier des hautes vallées alpines. Anciennes terres fiscales comme nous l’avons dit, elles ont échu au xie siècle aux seigneurs qui avaient hérité des rois de Bourgogne et d’Italie un pouvoir politique très morcelé. Dans les textes de donations, ils font plus volontiers référence à ce pouvoir qu’à la propriété de la terre. À la fin du xie siècle, c’est « dans la mesure où elle paraît faire partie tout entière de [son] comté », donc une circonscription de nature politique, que le comte de Genève donne la vallée de Chamonix aux bénédictins de Saint-Michel-de-la-Cluse, avec ses terres, ses forêts, ses alpages et ses chasses7. Cinquante ans plus tard, le sire de Faucigny concède comme territoire de pâture la rive gauche de la moyenne vallée l’Arve aux chartreux du Reposoir (Bornes), et la rive droite à ceux de Vallon (Chablais) ; il définit les territoires concédés comme ceux où s’appliquent sa « potée » (potestas) et son avouerie (advocatio)8. Ce n’est pas qu’avant de concéder ces vallées, ces seigneurs n’en faisaient pas un usage économique : les donations elles-mêmes laissent entendre qu’ils y chassaient et qu’ils y faisaient transhumer leurs propres troupeaux. Mais c’était une exploitation très extensive, qui s’accommodait sans difficulté de la présence de communautés paysannes locales soumises à leur juridiction et alors peu nombreuses. Celles-ci faisaient paître leur bétail depuis des temps immémoriaux, sous le contrôle lointain de seigneurs laïcs se contentant de percevoir çà ou là une dîme des agneaux nés dans l’année, ou une redevance en fromage.
16Il arrive que les seigneurs qui font don d’un pâturage à un monastère confirment explicitement les droits d’usage que leurs dépendants y détiennent, du seul fait d’une présence très ancienne : lorsqu’en 1251, le seigneur de Miolans cède à l’abbaye cistercienne du Béton la moitié de la montagne de l’Arclusaz, dans le massif savoyard des Bauges, il réserve les droits que ses hommes « y ont toujours possédé ». Mais ce n’est pas le cas le plus fréquent. Le plus souvent, les seigneurs donataires n’ont ni confirmé ni remis en cause les droits d’usage de leurs dépendants, laissant aux moines le soin de se débrouiller avec eux. La plupart des textes de donations ne les mentionnent pas ; parfois, ils restent dans une ambiguïté calculée : en 1135, les sires de Rovorée donnent à l’abbaye cistercienne d’Aulps sa part de l’alpage d’Avoriaz (haut Chablais), à condition qu’elle laissera à leurs hommes l’usage des pâturages boisés tant qu’ils seront incultes, mais sans se prononcer sur leur destinée une fois qu’ils seront défrichés9. Les chartes des acquisitions réalisées par les chartreux de Durbon n’étaient pas plus précises. Dans la vallée de la Burianne, là-même où leur monastère s’est installé, il y avait des exploitations paysannes. En sorte qu’en même temps que des terres, ils ont acquis des droits sur des hommes : en 1137 par exemple, Guillaume, seigneur de Montama, leur vend des prés, des terres et des bois avec les hommes qui les exploitent. Lorsqu’en 1155 les chartreux achètent à Eudes Aubouin les pâturages de Recours, dans la haute vallée d’Agnielles, le vendeur fait insérer la clause suivante : « Les colons qui résident en ce lieu n’ont aucun droit dans ledit bien, sinon ceux que vous voudrez bien leur donner, comme je le leur concédais moi-même de bonne grâce, en échange de leur service. » Le terme de « colons » évoque des défricheurs installés récemment, peut-être par le vendeur lui-même, qui semble en tout cas se désintéresser de leur sort10.
17Or les monastères ont beaucoup moins toléré la présence des paysans que les seigneurs laïcs qui les ont précédés. C’est surtout vrai des chartreux, très attachés, pour des raisons spirituelles, au respect de leur « désert » par les villageois des environs et à l’exploitation directe de leurs possessions. Parfois, ils tentent de négocier ou d’obtenir par voie judiciaire le départ de ces derniers : en 1255, la chartreuse d’Aillon, dans le massif des Bauges, acquiert de Thomas de la Balme l’alpage de Rossan. Elle obtient peu après, on ne sait trop à la suite de quelles pressions, le déguerpissement des hommes du village du Cimetière, chef-lieu de la paroisse d’Aillon. Mais cela ne se passe pas toujours aussi facilement. On trouve trace des premiers conflits dès le xiie siècle. En 1100, soit seize ans après sa fondation, la Grande Chartreuse obtient de l’évêque de Grenoble l’interdiction de toute activité profane dans les limites de son désert. Or, dès le commencement des années 1130, des paysans de Saint-Pierre-de-Chartreuse montent, avec l’appui des seigneurs de Vacher, faire les foins à l’alpage de Bovinant. Le prieur Guigues fait disperser le foin rassemblé et obtient de l’évêque de Grenoble un jugement en sa faveur. Non loin de là, dans le massif de Belledonne, les bois du désert de la chartreuse de Saint-Hugon sont dévastés par les bêtes des habitants des environs une vingtaine d’années seulement après la fondation du monastère11. La chartreuse des Écouges, fondée en 1116 dans la vallée de la Drévenne, au nord du Vercors, a eu avec les habitants de la paroisse voisine de Rencurel des rapports parfois exécrables. En 1193, des habitants du village rentrent par effraction dans deux granges du monastère. Dans l’une ils volent du grain et détruisent des outils ; dans l’autre, ils tuent une dizaine de bœufs. Pour obtenir que les coupables viennent se livrer eux-mêmes, il faudra que le prieur obtienne de l’évêque de Grenoble une sentence d’excommunication contre les gens de Rencurel. Et si l’on en croit la charte qui met fin à l’affaire, l’omerta aura duré assez longtemps pour qu’on voie des cadavres gisant sans sépulture dans les champs12.
18Mais c’est surtout au xiiie siècle que les conflits se multiplient, lorsque certains monastères, soucieux de constituer des ensembles économiquement cohérents, affirment leur emprise sur les pâturages de montagne, multipliant les acquisitions et tâchant de transformer les droits qu’ils ont acquis en propriété véritable. Or l’idée de propriété des alpages fait aussi son chemin chez les paysans. C’est pourquoi les fondations monastiques les plus tardives rencontrent de grandes difficultés. La chartreuse féminine de Prémol, en Dauphiné, est instituée en 1234 par Béatrice de Montferrat, comtesse de Vienne et d’Albon. Celle-ci lui donne « toute la montagne de Prémol au-dessus de la roche de Ferrière, avec les bois et les alpes ». Mais les communautés paysannes des paroisses de Vaulnaveys, Herbeys, Brié et Angonnes, réunies en « université » protestent en ces termes où se fait peut-être sentir une influence du droit romain : « Avant que fut fondée la maison de Prémol, disent-elles, les prédécesseurs des hommes de ladite université en avaient la quasi-propriété (erant in quasi-possessione), comme cela était bien connu dans les paroisses et lieux susdits. » Le conflit dure jusqu’en 1289, date à laquelle on transige ainsi qu’il suit : les religieuses s’engagent à recevoir dans leurs montagnes les vaches des manants des quatre paroisses susdites, moyennant 6 deniers par tête de bétail. L’inalpage se fera une semaine avant la Saint-Jean, pas avant. Le nombre de bêtes ne dépassera pas 120. Les troupeaux candidats à l’inalpage seront présentés au maître des pâtres du monastère, et pour toute bête qu’on tentera de faire monter en sus, il en coûtera 100 sous d’amende à verser au dauphin et 12 deniers d’indemnisation aux religieuses. Au commencement du xive siècle, le nombre de bêtes maximal est porté à 160 et même davantage si les paysans le souhaitent, à condition qu’on ne dépasse pas la capacité des pâturages. En l’occurrence, les communautés paysannes l’ont emporté, fortes qu’elles étaient de droits seulement coutumiers, certes, mais néanmoins solidement établis du fait de leur ancienneté13.
19Une plongée dans le riche chartrier de Léoncel va nous donner une idée de la manière dont les monastères ont œuvré à constituer des ensembles fonciers cohérents, non se heurter aux intérêts des autres acteurs économiques. Il contient une petite trentaine de chartes relatives à l’alpage d’Ambel, un plateau du Vercors qui culmine à 1581 m d’altitude et dont les 1 500 ha de pâture et de forêt sont gardés par de hautes falaises14. Peu après leur installation (1137), les cisterciens y acquièrent leurs premiers pâturages de Guillaume Lambert, seigneur de Gigors. En 1169, le fils de celui-ci conteste déjà la donation. En 1191, un autre seigneur, Odon de Quint, qui s’apprête à partir en pèlerinage à Compostelle, donne à son tour aux cisterciens des pâturages à Ambel. En 1201, une charte du pape Innocent III énumère, parmi les possessions de l’abbaye « les pâturages d’Ambel ». Oui, mais lorsqu’en 1212 Lantelme de Gigors confirme les donations de ses ancêtres de Quint et de Gigors, il précise que les moines doivent se garder de porter atteinte aux moissons et aux prairies de fauche « défendues et améliorées depuis longtemps » à Ambel. Il réserve aussi le droit de pâture des « habitants du lieu », qui sont en fait les paysans des vallées adjacentes de la vallée de Quint et de la Gervanne, car il n’y a pas d’habitat permanent sur le plateau. C’est que ses ancêtres n’ont pas pu donner plus que ce qu’ils avaient : en droit, des pâturages, en fait, plutôt des droits de pâture qu’ils partageaient avec leurs dépendants ; en tout cas, certainement pas une propriété foncière au sens plein du terme. Il n’y a pas de propriétaires à Ambel au commencement du xiiie siècle, mais seulement des usagers, seigneurs laïcs, paysans et cisterciens. C’est pourtant bien à une vraie propriété que les moines vont prétendre au cours du siècle. Ils vont se heurter aux communautés paysannes de la vallée de Quint, qui protestent de leurs droits d’usage immémoriaux, et aux seigneurs de Gigors et d’Eygluy. Ces derniers, interprétant largement les droits que conférait aux autochtones la donation de 1212, revendiquent pour eux et pour leurs hommes de la vallée de Quint le droit de faire monter à Ambel non seulement leurs troupeaux, mais aussi ceux qu’ils prennent en garde pour l’été. Ils doivent renoncer à cette prétention en 1228. Dans les décennies suivantes, les cisterciens marquent des points. Comme le flux des donations a tendance à se tarir, ils achètent des parcelles de prés et des droits de pâture à des particuliers, nobles ou non, parvenant à réduire un certain nombre d’enclaves situées principalement au nord-ouest du plateau, dans le quartier dit de la Chaumate, auquel ils s’intéressent particulièrement. Dans plusieurs chartes postérieures à 1244, ils se font reconnaître le droit de pâture sur tout le plateau, y compris sur les prairies de fauche, après la Saint-Michel – ou la Saint-Julien selon les quartiers ; aux détenteurs de ces prés de faire les fenaisons auparavant. En 1258, Humbert de Gigors leur reconnaît le droit de bâtir des maisons et des granges sur tout le plateau, attestation qui leur coûte 100 s. viennois. Ils rachètent des cens qu’ils devaient à divers seigneurs pour des prés qu’ils tenaient en fief. En 1269, le seigneur de Rochechinard leur conteste d’abord le droit de bâtir dans les bois de la Chaumate une celle – un bâtiment d’alpage – pour y faire le fromage, mais il doit finalement reconnaître qu’ils sont fondés à le faire car « ils détiennent en cet endroit la propriété du sol » (proprietas ipsius soli). Il n’empêche que les paysans du lieu continuent d’y avoir des droits d’usage. Dans les dernières décennies du xiiie siècle, les cisterciens ont affaire à plus forte partie, car les seigneuries de Quint et de Gigors ont échu au comte de Valentinois. En 1266, le châtelain qui tient le mandement de Quint pour ce dernier leur demande encore le droit de faire monter des troupeaux sur les pâturages d’Ambel, « qui appartiennent à [leur] abbaye ». Mais en 1288, Aynard de Poitiers, comte de Valentinois, fait bâtir à son tour une celle à Ambel, sans demander la moindre autorisation, malgré la protestation solennelle du cellérier de l’abbaye. La pression sur le monastère devient telle que les cisterciens doivent composer. En 1303, une sentence arbitrale répartit ainsi les droits respectifs de l’abbaye et d’Aynard de Poitiers : l’abbaye est sous la juridiction du comte de Valentinois, au titre du mandement d’Eygluy, dont il est seigneur. Elle possède la Chaumate en pleine propriété, moyennant les droits de pâture des paysans du lieu ; elle exerce sur le reste d’Ambel la coseigneurie avec le comte. Elle partage avec lui le revenu des taxes levées sur les troupeaux qui montent au plateau ; les coseigneurs fixent ensemble le nombre de trentains d’ovins qu’ils peuvent chacun y inalper ; ils établissent les itinéraires de pâture. En résumé, au commencement du xive siècle l’abbaye est coseigneur d’Ambel, mais en position de faiblesse par rapport au comte de Valentinois. Elle possède une partie de l’alpage en pleine propriété, mais les communautés paysannes y ont des droits de pâture. Dans le reste de l’alpage elle n’est pas propriétaire, mais c’est elle qui possède des droits d’usage. Pour compliquer encore un peu les choses, le comte de Valentinois recommence à inalper du bétail étranger au commencement du xive siècle. On le sait parce qu’en 1339, les communautés de la vallée de Quint tentent en vain de s’y opposer15.
20Les conflits entre communautés rurales autochtones et communautés religieuses sont une part de la réalité alpine. Mais il faut se garder de considérer ce seul aspect des choses. Car on a aussi des preuves d’une collaboration pour la mise en valeur de la montagne.
Les conquérants de l’utile
21Certes, les litiges sont surreprésentés dans les archives monastiques. Les monastères heureux n’ont pas d’histoire, et les rapports de bon voisinage laissent beaucoup moins de traces que les conflits, lesquels sont généralement connus par les suites judiciaires qu’ils ont eues. Entre deux conflits documentés, des décennies de paix se laissent voir en creux, surtout avant 1250. Des relations plus positives se laissent également deviner. Parmi les bienfaiteurs de Léoncel par exemple, il y a 15 à 30 % de paysans, évaluation minimale car les aumônes des paysans, plus modestes que celles des seigneurs, ont laissé moins de traces dans les archives. Léoncel recrute d’ailleurs ses convers et ses mercenaires parmi les paysans des alentours, comme le montrent leurs anthroponymes16. Surtout, les mêmes religieux que nous voyons fermer certaines montagnes aux communautés paysannes ou tenter de le faire, en ont ouvert d’autres à la colonisation, faisant largement appel aux défricheurs.
L’essartage dans les Alpes occidentales et méridionales
22Restons à Léoncel : lorsqu’en 1174, Guidelin de Royans donne au monastère la montagne de ce nom,
« Ledit Guidelin affirme qu’il n’y a [sur cette montagne] aucun tenancier ni villageois à l’exception des Bertrand. Si un autre villageois demande à s’y installer, Guidelin devra le convoquer pour qu’il soit entendu par lui-même et par les frères de Léoncel. […] Et le cens et la tâche, et tout ce qui était dû audit Guidelin leur sera dû. »
23On voit que la donation de cette montagne alors quasiment déserte est assortie du projet de continuer une opération de colonisation à peine entamée par le donateur. Ce dernier ne se retire pas sans avoir préalablement participé à la sélection des hôtes. Le résultat, c’est qu’en 1296, au terme d’une enquête diligentée par l’administration du dauphin sur les droits du monastère sur la montagne de Léoncel, il apparaît qu’elle est couverte de prés, de champs emblavés en céréales et, encore, de quelques forêts. Aux dires des témoins, les moines perçoivent alors le treizième des blés au temps des moissons, au titre de la tasque. Ils ont le droit de donner à qui il leur plaît le droit de couper du bois, d’essarter et semer dans les montagnes de Musan, Valfanjouse, la Charge et la Saulse17. Si l’on ne peut exclure que leurs convers et leurs mercenaires aient directement mis la main à la pâte, les cisterciens apparaissent beaucoup plus comme encadrant les défrichements et organisant la colonisation que comme défricheurs eux-mêmes. Ils ont sans doute également fourni les équipements les plus onéreux, comme cette celleque nous les voyons construire dans le bois de la Chaumate en 1269.
24L’essentiel de la main-d’œuvre des défrichements a donc été fournie par les paysans. Les religieux, du reste, n’auraient jamais eu les effec-tifs nécessaires, les monastères alpins dépassant rarement la douzaine de moines et de convers. Nous connaissons d’ailleurs les modalités pratiques de l’essartage en Dauphiné par un témoignage des paysans eux-mêmes. Ce beau texte, jadis exhumé par Thérèse Sclafert, est un peu tardif, mais il évoque sans aucun doute des techniques très anciennes. Comparaissant en 1447 devant les enquêteurs du roi de France commis aux révisions de feux, les habitants des villages d’Eygluy, du Cheylard et de Baix, dans le Diois, expliquent leurs méthodes. C’est avec l’espoir de montrer combien sont rudes leur conditions de travail et d’obtenir de la sorte une réduction de leur contribution à l’impôt royal :
« Nos terres sont pauvres et peu fertiles, et il nous faut en gagner sur les bois. On coupe en effet les arbres durant l’hiver et on les étend sur place. Une fois qu’ils sont secs, on y met le feu, ce qui brûle aussi quelque-peu la terre qui se trouve en-dessous. On peut alors y semer du blé, car la terre est fertilisée pour quatre ans, cinq au maximum. Mais ensuite elle ne vaut plus rien pour les vingt années à venir, à moins qu’on n’y mette du fumier. Or cela n’est pas possible, parce que nous n’avons pas d’animaux, faute de prés. Le peu de prés que nous avons, nous y faisons des foins. En sorte qu’après que nous avons travaillé la terre quelques années en un endroit, il nous faut aller défricher une autre portion de bois les années suivantes, ce qui ne va pas sans un grand labeur18. »
25S’ils ne comprennent pas les vraies raisons de la fertilisation du sol, qu’ils attribuent à son réchauffement par le feu et non à l’accumulation des cendres, les témoins connaissent fort bien les effets de leur pratique : un accroissement spectaculaire des rendements mais, faute d’engrais animal, un épuisement rapide qui impose de recommencer l’opération en un autre endroit. L’essartage dont il est ici question est en fait une culture temporaire sur brûlis. La création de champs ou de prairies temporaires sur la friche est attestée par de multiples témoignages dans les Alpes occidentales et méridionales aux xiiie et xive siècles19. Dans l’état actuel de nos connaissances, les témoignages les plus anciens concernent la Haute-Provence et le Dauphiné méridional : dans les années 1230-1260, les paysans des communautés de Savines et des Crottes essartent les bois de l’abbaye de Boscodon, ce qui ne va pas sans conflit avec les religieux. Un peu plus au nord, les enquêtes sur les droits des dauphins réalisées à la mi- xiiie siècle notent qu’on cultive également sur brûlis en Oisans, Beaumont, Vercors, Valcluson, Vallouise, Briançonnais, etc. En Savoie, des essarts et des « foyères » sont bien attestées dans le massif des Bauges, dans celui de Belledonne, en Tarentaise et en Maurienne au tournant des xiiie et xive siècles. Au même moment, des essarteurs maladroits sont condamnés pour avoir incendié des forêts entières dans le Valais occidental.
26Ce sont donc les friches communes, celles qu’on appelle « hermes », « terre gaste » ou encore « pastègues » dans les Alpes méditerranéennes, qui sont attaquées par les essarteurs. Communes, c’est dire qu’elles sont à tout le monde, ou plutôt que chacun a le droit d’en user ; mais c’est dire aussi que nul n’a le droit de se les approprier, en sorte que d’une certaine manière elles n’appartiennent à personne. « Heremi nullius sunt » : les hermes ne sont à personne, affirment les habitants de Saint-Martin-de-Queyrières, en Briançonnais, aux enquêteurs delphinaux. Or, beaucoup plus que la pâture du bétail ou la coupe du bois de chauffe, la culture sur brûlis suppose une appropriation, au moins temporaire, d’une portion bien délimitée du territoire commun. Cela ne pose pas de problème tant qu’il y a de la place pour tout le monde ; mais depuis le xiiie siècle, la pression sur les communs s’intensifie avec la croissance démographique, d’où des conflits croissants entre communautés. C’est la porte ouverte à une intervention des seigneurs détenteurs du ban. Du point de vue des communautés, la nécessité d’une instance arbitrale se fait sentir pour empêcher les appropriations abusives des communaux et la déforestation excessive ; du point de vue seigneurial, il y a là une intéressante perspective de taxation. Nous voyons ainsi les seigneurs mettre en défens certaines forêts ou, comme on dit plutôt dans les Alpes, y apposer des bans, en accord, bien souvent, avec les communautés paysannes qui voient avec inquiétude, dans les régions méditerranéennes, la déforestation gagner du terrain. Quant à la culture temporaire sur brûlis dans les friches communes, elle est autorisée selon certaines règles et moyennant le paiement au seigneur banal d’une redevance proportionnelle au rendement de la terre qu’on appelle terrage en Savoie, tasque ou tâche en Dauphiné et en Provence. Fixés fréquemment au 1/12e du rendement de la terre, ces prélèvements peuvent toutefois varier entre le 1/7e et le 1/20e.
27Selon les termes de l’enquête delphinale de 1250, les habitants d’Oulx (Valcluson), peuvent faire des essarts où ils le veulent dans les communs, à condition de payer la tasque au seigneur. « Une fois la terre essartée, ils ne peuvent toutefois la conserver ni se l’approprier, ni y construire une maison, sauf s’ils ont préalablement reçu l’accord du seigneur dauphin20. » C’est dire que l’appropriation définitive de certaines terres communes est interdite en principe mais possible en fait, moyennant l’autorisation du seigneur et la reconnaissance de son domaine éminent. À mesure qu’on avance dans le xiiie siècle, la pression en ce sens est de plus en plus forte, car de plus en plus de jeunes hommes, chefs d’exploitation potentiels, peinent à s’établir sur les terroirs anciens, faute de place. Il ne leur suffit plus de gagner quelques parcelles marginales et précaires, ce sont des exploitations entières qu’ils aspirent à créer. Cela suppose d’ailleurs des essais temporaires, des tentatives avortées. La charte de franchises de Bardonnèche, Rochemolles et Béaulard (1330) prend acte de cette période transitoire par laquelle passent certaines jeunes exploitations et vise à la faciliter : les habitants, dit-elle, ont le droit de déplacer leurs maisons librement si elles sont en bois, et de changer de seigneurie une fois par an au maximum : leur seigneur de l’année est celui du lieu où ils ont passé la Noël21.
28La paroisse d’Arith, dans le massif des Bauges, fournit un exemple bien documenté de transition entre les traditionnels essartages temporaires et l’extension définitive de l’espace cultivé, au commencement du xive siècle22. Elle fait partie au Moyen Âge de la châtellenie du Châtelard, qui appartient au comte de Savoie. Mentionnée dès le ixe siècle, cette paroisse s’est développée autour de trois hameaux dont les toponymes préromain (Arith) et gallo-romains (Montagny, Bourchigny) témoignent qu’il s’agit de noyaux de peuplement très anciens. Au commencement du xive siècle, ces villages sont formés d’une juxtaposition assez lâche de « choseaux », c’est-à-dire de parcelles supportant une maison d’habitation, sa cour et son jardin, et ils sont entourés d’une ceinture de labours. C’est un terroir céréalier d’altitude moyenne (700 m), ouvert et très anciennement mis en valeur, où l’on cultive du froment, de l’avoine et du seigle, et où subsistent des portions de communs relevant des hameaux. À quelques centaines de mètres au-dessus du noyau primitif, se trouvent des alpages très anciennement exploités eux aussi, les « monts » de la Chavonne, du Mariet, du Creux de Lachat, qui s’étendent entre 900 et 1 300 m environ, et où les habitants d’Arith ont leur usage, en échange de taxes acquittées au comte de Savoie pour la pâture (pasqueragium), la coupe du bois (affoagium) et le ramassage de la litière (bocheagium). Autour de ces alpages se trouvent des « bois noirs », c’est-à-dire des forêts de conifères mises en défens. Pour satisfaire à la pression démographique, le comte, au commencement du xive siècle, y a pourtant ouvert des « prises » (preysie), c’est-à-dire des parcelles ouvertes à la conquête, en sorte que la prairie gagne du terrain. Mais c’est entre la « plaine d’Arith » et les monts, dans un espace de transition longtemps laissé à la friche et aux bois, que se développe le principal front pionnier au tournant des xiiie-xive siècles. À l’ouest, c’est d’abord le territoire de Montorset, que le comte de Savoie achète en 1303 à un petit seigneur bauju, Jean d’Arveys. Ce dernier y avait installé cinq « hôtes », c’est-à-dire cinq colons, à la fin du xiiie siècle. En 1308, leurs descendants sont déjà au nombre de neuf. Lorsqu’on quitte le plateau d’Arith en direction du sud-ouest, la vallée se ferme et ses flancs s’élèvent. On y trouve aujourd’hui les villages du Champ, de Charmillon, du Mouchet et de La Magne. Formés de parcelles alignées le long du chemin et s’enfonçant dans la forêt toute proche, ils ont une forme typique de villages de colonisation, ce que confirme l’extente (censier) de 1335, qui qualifie « d’hôtises » (ospicia) les exploitations qu’on y trouve. Les hameaux du Champ et de Charmillon ne comptent respectivement que huit et six feux en 1335, mais ils sont alors en pleine croissance : à eux deux, ils ont tout de même gagné six feux depuis 1325, soit un gain de 40 % en dix ans. Les hôtes ne viennent pas de très loin. Leurs anthroponymes témoignent qu’ils sont originaires d’Arith ou des paroisses limitrophes. La colonisation baujue a donc servi à éponger le trop plein de la natalité locale. Devenir chef d’exploitation est peut-être un rêve pour beaucoup de paysans vivant sur des exploitations surchargées, mais les commencements sont difficiles : en 1323, les hôtes du Champ et de Charmillon durent être dispensés de la miche de pain qu’ils devaient annuellement au titre du pasqueragium, parce qu’ils étaient trop pauvres pour la fournir.
29Une fois les exploitations nouvelles suffisamment viables, il convient de les pérenniser en droit. Il faut que le prince en délègue officiellement et définitivement le domaine utile ; ainsi appelle-t-on en droit seigneurial l’usage concret d’un bien foncier, y compris la capacité de le transmettre et de l’aliéner. Il ne conserve pour lui que le domaine éminent, qui lui donne le droit de lever taxes annuelles et droits de mutation. La renaissance du droit romain, acquise en Provence au xiie siècle et qui se manifeste en Dauphiné et Savoie au siècle suivant, fournit le contrat ad hoc. Dans les Alpes méditerranéennes on l’appelle bail à acapte ou emphytéose perpétuelle ; en Savoie et Dauphiné, albergement emphytéotique. On sait que droit romain remet en valeur la notion de propriété. Aussi le caractère définitif de la délégation du domaine utile est-il assuré en contrepartie du versement, par le tenancier, d’un droit d’entrée en possession, ici appelé « introge » et là « acapte », qui fait de la concession une quasi-vente. Le détenteur du domaine utile devient, en termes de droit romain, un quasi-propriétaire : il jouit de tous les attributs de la propriété, c’est-à-dire du droit d’user et d’abuser, mais à condition d’acquitter les taxes. L’introge est un peu inférieur à la valeur réelle du bien, puisque celui-ci reste chargé de redevances, mais il représente pour les seigneurs concédant une rentrée importante. Nous verrons bientôt l’usage qu’ils en font sur les alpages. À Arith en tout cas, le comte de Savoie se livre à des régularisations massives à la veille de la grande peste : en 1342 et 1343, il perçoit vingt-quatre introges sur des paroissiens d’Arith, soit pour des hôtises complètes, soit pour de simples essarts devenus parcelles permanentes de prés ou de champ.
30Noter qu’à des hôtes qui ne viennent que de la paroisse voisine, les seigneurs n’ont pas de raison de concéder des conditions fort avantageuses. C’est que le marché foncier et celui du travail sont alors extrêmement favorables aux seigneurs : les bras sont en abondance, c’est l’espace qui commence à manquer. Aussi à Arith, les tenanciers du mas de Charmillon sont-ils pour la plupart soumis à la taille à merci, la plus lourde des redevances seigneuriales. La tasque, quant à elle, a fréquemment tendance à se transformer en taxe fixe une fois la concession devenue définitive23. Certes il est d’abord avantageux pour le défricheur d’acquitter des redevances proportionnelles à ses récoltes, car sur les terres fraîchement mises en cultures, les rendements des premières années sont aléatoires. Mais ensuite, les rentrées seigneuriales augmentent à mesure que la terre rend davantage, et le paysan soupire après les redevances fixes ; comme les seigneurs, de leur côté, s’épuisent à lutter contre les fraudes inhérentes à tout prélèvement proportionnel, un consensus s’établit fréquemment pour acenser la tasque.
31Les vallées des Alpes occidentales et méridionales étaient donc anciennement occupées, comme en témoigne la présence, surtout dans le sud, de communautés paysannes déjà solidement implantées au moment de la fondation des monastères. Les défrichements du Moyen Âge central ont eu pour objet d’achever leur mise en valeur, par l’extension des pâturages de sommet et la densification des habitats de fond de vallée, mais surtout par la conquête des versants intermédiaires, zone la moins propice, par sa raideur, à l’activité humaine, et donc la plus tardivement conquise. Les défrichements, qui se sont poursuivis plus tardivement qu’en plaine, paraissent avoir surtout employé le trop-plein de la main-d’œuvre locale.
32Plus au nord, la colonisation des hautes vallées a fait l’objet d’entreprises plus spectaculaires.
La colonisation des Alpes centrales et septentrionales
33La main-d’œuvre, en effet, y a été fournie en partie par des colons venus d’assez loin, s’offrant à seconder l’effort des populations locales. Le phénomène de loin le mieux documenté, même s’il n’est pas exclusif, est celui de la colonisation germanique des xiiie et xive siècles. En fait, il s’agit des nouveaux développements de l’expansion alémanique vers le sud, qui fut entamée, comme nous l’avons vu, au haut Moyen Âge.
34Dans les Alpes orientales, elle est surtout le fait des Suèves et des Bavarois, qui ont gagné les massifs méridionaux (Sud-Tyrol, Trentin, Frioul) à l’appel des évêques de Vérone et de Trente, mais aussi de nombreux monastères et seigneurs laïcs. Dans le Trentin par exemple, la colonisation germanique est attestée par les sources écrites depuis le début du xiiie siècle, et semble aller croissant jusque dans les premières décennies du xive. Les évêques de Trente installent des colons en Valsugana, en Vallarsa, en Val di Non, dans la vallée de Terragnolo, sur le haut plateau de Lavarone, etc. Les seigneurs laïcs les imitent. Ces opérations de colonisation systématique portent le nom latin d’ammansatio. Souvent situés sur des pans de versants d’où la forêt n’a pas encore été chassée, les territoires à mettre en valeur sont lotis en en manses, c’est-à-dire en exploitations concédées à une famille de défricheurs (roncatores). L’habitat dispersé qui en résulte s’oppose aux villages romans plus groupés des fonds de vallée. Gardant jusqu’au siècle des Nationalités leur identité ethnolinguistique, ces isolats de peuplement germanique deviendront alors, selon le mot de Gian Maria Varanini, des « signes de contradiction » au milieu des populations italianophones24.
35Dans les Alpes centrales et septentrionales, la célèbre migration dite des Walser a donné lieu depuis deux siècles à une littérature très abondante25. Au xe siècle, un groupe d’Alamans quitte la haute vallée de l’Hasli (Oberland bernois), franchit le col du Grimsel et se fixe dans le Goms, en amont de la vallée du Rhône. Au cours des siècles suivants, ils occupent et germanisent les vallées latérales du Valais (Binn, Simplon, Saas, Zermatt, Lötschental). Leur expansion recommence au tournant des xiie-xiiie siècles. Elle les mène en un siècle et demi à coloniser les vallées les plus hautes et les plus déshéritées des Alpes centrales, du Faucigny au Tyrol et du Vorarlberg au Tessin. À l’est ils sont connus sous le nom de « Valaisans », en allemand Walliser ou Walser ; au nord on les qualifie de Lötscher (originaires du Lötschental) ; dans les pays romans de l’ouest et du sud, où c’est leur dialecte germanique qui a frappé les autochtones, on les appelle « Allemands » ou « Teutons ».
36Au cours du xiiie siècle, quelques groupes descendent la vallée du Rhône, certains atteignant les abords du massif du Mont-Blanc. D’autres, plus nombreux, franchissent le col de Gries et pénètrent dans la haute vallée lombarde du Toce, où ils fondent Formazza, « colonie-mère » qui constitue par la suite un des principaux points de départ des Walser. De là en effet, ils s’étendent au sud-ouest, colonisant les hautes vallées du versant méridional du Mont-Rose (Valle Anzasca, Valsesia, Gressoney, Valtournenche) ; puis ils s’établissent en Valle Maggia et dans le Rheinwald, entamant un mouvement d’expansion vers le nord et l’est, qui va les mener jusqu’au Schanfigg et au Prättigau, et même jusqu’au Vorarlberg et au Tyrol, qu’ils atteignent avant 1320. Les effectifs en jeu ne sont pas très abondants : les défricheurs valaisans sont partis à l’aventure par petits groupes de dix à vingt familles. Ce qui les pousse ainsi à migrer, c’est la nécessité d’éponger une démographie dynamique. L’expatriation leur est rendue plus aisée par les liens vivaces entre les différentes colonies germaniques, au point qu’on devine l’existence de véritables réseaux d’émigration. En 1256 par exemple, les douze colons auxquels les chanoines du chapitre de San Giulio d’Orta concèdent l’alpage de Rimella et les deux-tiers de celui de Rondo proviennent des vallées de Saas, de Viège et du Simplon.
37Les colons sont appelés par les détenteurs de droits banaux ou fonciers sur les montagnes. Ce sont en premier lieu des monastères : en Faucigny, les cisterciens d’Aulps et les bénédictins de Chamonix ; dans la Valle Anzasca, l’abbaye San Gracignano d’Arona ; dans le bassin du Rhin antérieur, le monastère de Disentis ; dans le Schanfigg, les prémontrés de Churwalden ; dans la vallée de Calfeisen, les bénédictins de Pfäfers ; dans le Vorarlberg, ceux de Saint-Gérold et les augustins d’Ebnit ; en Engadine, les bénédictins de Marienberg et les bénédictines de Mustaïr, etc. Ce sont aussi des évêques, des chapitres cathédraux (Coire) ou canoniaux (San Giulio d’Orta). Mais les entreprises de colonisation doivent également beaucoup à l’initiative de seigneurs laïcs. Dans les vallées méridionales du massif du Mont-Rose, les seigneurs de Challant, de Vallaise et de Cly ont installé divers groupes de colons germaniques. Dans le Rheinwald, les Sacco, seigneurs de Mesocco, les barons de Vaz et les comtes de Werdenberg Sargans sont à l’origine de plusieurs implantations. Les Werdenberg ont également attiré les Walser sur leurs terres du Vorarlberg, à l’imitation des comtes de Montfort, etc.
38En fait, bien des entreprises de colonisation ont pour origine une collaboration entre un puissant laïc et une communauté religieuse. Lorsqu’un seigneur donne ou vend une terre à un monastère, c’est parfois qu’il y a une opération de colonisation à la clé. Nous l’avons vu, en Vercors, pour le cas de Léoncel au xiie siècle. Les Alpes du nord en donnent des exemples extrêmement tardifs, qui laissent entendre qu’elles n’ont pas été exploitées à fond avant le commencement du xive siècle : en 1313, les sires de La Roche vendent la montagne de La Berra (Préalpes vaudoises) à la chartreuse de la Valsainte. Ils spécifient ce qui suit :
« Le prieur et le couvent de ladite maison de la Valsainte peuvent et doivent faire dans lesdits bois, forêts et montagnes des défrichements, des essarts, des cultures, des champs, des prés, des chosaux, des maisons et d’autres édifices, y alberger des hommes, des albergataires, des cultivateurs, et donner à cens ces essarts, ces cultures, ces champs, ces chosaux et ces édifices26. »
39À l’inverse, l’entreprise de colonisation peut passer par l’inféodation d’une terre ecclésiastique à un laïc. En 1292, un des contrats les plus explicites que nous ayons conservés nous renseigne sur une opération de colonisation au col de la Croix, sur le versant nord de la chaîne des Diablerets, aux confins du Chablais suisse, de la Gruyère et de l’Oberland bernois. L’abbé de Saint-Maurice d’Agaune, détenteur des alpages d’Ansey, d’Arpille, d’Orgevaux et de Culant, tous situés entre 1 700 et 1 800 m d’altitude, les concède en fief à Pierre de La Tour-Châtillon. Les La Tour-Châtillon sont possessionnés à la fois dans le Lötschental et l’Oberland bernois. En association avec la famille des Wädiswil, à laquelle ils sont liés par mariage, ainsi qu’avec l’abbaye d’Interlaken, ils sont les principaux artisans de l’installation de colons Lötscher dans les quelques hautes vallées qui restent alors à conquérir dans l’Oberland Bernois. En inféodant à Pierre ces alpages dont ils n’ont guère l’usage, les chanoines de Saint-Maurice ont donc fait appel à un expert en matière de colonisation. Celui-ci s’engage à y installer quelques-uns de ses dépendants Lötscher, afin qu’ils « y bâtissent, qu’ils y habitent, qu’ils y cultivent, et qu’ils les mettent en culture ». Le but est donc bien de transformer des alpages peu ou pas exploités en habitat permanent. En l’absence de textes postérieurs, il n’est d’ailleurs pas certain que l’opération ait été un succès27.
40Les succès, pourtant, sont nombreux, et souvent, les entreprises de peuplement nous sont connues à l’occasion d’accords par lesquels seigneurs laïcs et ecclésiastiques se partagent les revenus à percevoir sur les colons. En 1200, l’abbaye augustine de Sixt obtient du sire de Faucigny l’assurance qu’il ne lèvera pas la taille sur les familles qu’elle installera dans le massif du Giffre. À la même époque, l’abbaye bénédictine de Saint-Michel-de-la-Cluse (Piémont) a fondé à Megève un prieuré sur des terres à elle données par le même sire de Faucigny. En 1226, l’abbé passe avec Aymon II de Faucigny l’accord qui suit : l’abbaye se donne comme objectif de tirer un revenu de 1 000 sous des mas qui se trouvent sur les terres du prieuré. Si leurs exploitants du moment ne suffisent pas à fournir cette somme, elle pourra en installer d’autres. Au cas où elle ne trouverait pas de colons en nombre suffisant, elle installerait ceux que lui présentera Aymon. Fondé par les Faucigny à la fin du xie siècle, le prieuré clunisien de Contamine-sur-Arve reçoit à la fin du xiie le patronage et l’essentiel des droits seigneuriaux dans la paroisse montagnarde des Gets. Le peuplement s’en fait lentement, puisqu’au commencement du xive siècle encore, Hugues Dauphin, successeur des Faucigny, y installe des colons contre un cens et d’autres contre une taille. Un accord passé en 1313 spécifie que les uns et les autres devront reconnaître tenir leurs biens du prieuré de Contamine, qui percevra à ce titre les cens et les droits de mutation. Mais les cens seront reversés à Hugues28.
41En 1286, les chanoines du chapitre de San Giovanni e San Vittore in Mesolcina concèdent à un groupe de seize Walser quelques alpages du Rheinwald, qui leur ont jadis été donnés par les Sacco, seigneurs de Mesocco. C’est, là encore, pour qu’ils y établissent un habitat permanent, et c’est parce que ces biens n’étaient alors aux chanoines que « d’une faible utilité et d’un petit rapport29 ». La motivation des seigneurs concédant est évidente : mettre en valeur des terres jusqu’alors exploitées de façon très extensive, de manière à en tirer des revenus seigneuriaux plus importants. Mais pour le colon, la tâche de mise en valeur est rude, les profits différés voire incertains, d’autant plus que les terres les plus faciles à mettre en valeur sont aux mains des populations autochtones. Il faut donc que les conditions d’installation soient assez avantageuses pour motiver une expatriation. Les Alpes nord-occidentales connaissent elles aussi une tenure de défrichement appelée albergement ou abergement30. Mais dans ces régions de droit coutumier, il ne s’agit pas d’une emphytéose. Il n’est point besoin au tenancier de verser un introge pour obtenir une concession définitive et héréditaire. La tenure est aliénable moyennant l’acquittement de droits de mutation, et principalement chargée d’une redevance annuelle fixe, qualifiée de cens ou de servis. Il n’est pas rare que la condition juridique des colons soit plus avantageuse que celle des autochtones. La villa de Vuarrens, située sur le plateau du Jorat, dans le pays de Vaud, est peuplée depuis l’époque burgonde au moins. Mais au début du xiiie siècle elle a souffert des guerres entre le comte de Savoie et le duc de Zähringen, au point que la forêt a regagné sur les champs. Le chapitre cathédral de Lausanne y alberge des colons venus « d’outre-Jura ». Ils bénéficient de l’exemption de la taille arbitraire qui frappe les tenanciers autochtones. Les actes du pays de Vaud affirment que les « abergiors »sont libres, par opposition aux serfs qui sont nombreux dans cette région. De même, les « Allemands » albergés à Vallorcine par les bénédictins de Chamonix en 1264 se reconnaissent « hommes lige » du prieuré, ce qui évoque une dépendance exclusive de la fidélité à tout autre seigneur. Mais ce ne sont pas vraiment des serfs car ils sont libres de déguerpir, à condition de ne céder leurs biens qu’à d’autres hommes liges du prieuré. Ils sont en outre explicitement exemptés de toute corvée et ne doivent qu’une redevance collective en argent, fixe et modérée31.
42Dans les pays de langue germanique, le contrat équivalent à l’albergement est l’Erblehen, ou « concession héréditaire ». Les relations entre l’autorité seigneuriale et le petit groupe de colons qui bénéficie de la concession passent souvent par l’intermédiaire d’un entrepreneur de colonisation, figure connue dans toute l’Europe des défrichements sous le nom de locator. Les Erblehenbriefe nous ont gardé les noms de plusieurs de ces fondateurs de communautés : à Bosco Gurin, ser Henri Bruchard, consul (1253) ; à Rimella, Jean, fils de ser Pierre, de Visperterminen (1256) ; à Davos, l’Ammann Wilhelm (1289), etc.32. Le titre de consul, d’Ammann ou encore de Gastald dont certains sont décorés signifie généralement que le seigneur leur concède une juridiction sur leurs semblables. C’est le cas de l’Ammann Wilhelm, avec lequel Hugo von Werdenberg et les fils de Walter, baron de Vaz, contractent en 1289. Ils reconnaissent que le territoire de Davos lui est concédé à titre héréditaire à lui et à ses compagnons, contre une redevance de 473 fromages, 168 mesures de toile et 56 jeunes têtes de bétail ou l’équivalent de tout cela en argent, outre un millier de poissons spécialement dus en carême pour l’usage du lac. Ils doivent en outre le service militaire. Wilhelm a le titre d’Ammann, et après lui celui que la communauté se choisira. L’exercice de la justice lui revient, à l’exclusion du châtiment du meurtre et du vol, qui restent justiciables de la cour des barons de Vaz. Tous les crimes devront toutefois être jugés dans la vallée. La responsabilité de l’Ammann n’est pas inégale à ses prérogatives : il répondra sur ses biens propres de l’exact paiement des redevances. À la différence des contrats à tâche qu’on rencontre dans les Alpes méditerranéennes, les Erblehenbriefe et les albergements fixent généralement le montant des redevances dès le départ, et il n’est pas prévu que celui-ci croisse à proportion de la mise en valeur de la terre. En 1277, Walther de Vaz s’engage à ne rien exiger des Walserdu Rheinwald au delà de la somme de vingt livres qu’ils lui doivent chaque année à la saint Martin33. Ils sont libres de se répartir comme ils l’entendent le poids de cette taxe, ainsi que toutes les charges communes. Ils peuvent en outre se choisir un « ministre » – en latin minister, en allemand Gastald – pour leur rendre la justice, le baron de Vaz conservant pour lui le châtiment du vol et de l’homicide et l’appel de toutes les causes. Ils lui doivent le service militaire, y compris pour une éventuelle chevauchée lointaine, mais il devra les indemniser de leurs dépenses, « depuis le jour et l’heure où lesdits Teutons auront quitté leurs maisons et leur vallée et jusqu’au moment de leur retour ». En 999,lorsque l’archevêque de Milan en fait don aux bénédictins de San Gracignano d’Arona, Macugnaga n’est qu’un alpage au sommet de la Valle Anzasca. C’est encore un alpage en 1208 lorsque les bénédictins le concèdent pour vingt ans à Enrico di Stresa. En 1291, c’est un village. Il y a alors des « hommes de Macugnaga » : ce sont les Walser. En l’occurrence ils sont représentés par les syndics de la Valle Anzasca, mais ils possèdent et gèrent leurs propres communaux. De la même manière, Gressoney, sur le versant sud du Mont-Rose, est cité comme un alpage en 1219 et comme un lieu d’habitat permanent en 1242, date à laquelle on y trouve un tenancier du nom d’Alamanus. On pourrait ainsi multiplier les exemples : les Walser ont volontiers fondé leurs colonies à de très hautes altitudes, souvent aux alentours de 1 800- 1 900 m. Plus haut, ils n’auraient pas pu établir de cultures permanentes. À cette altitude, la culture céréalière était encore possible, à condition d’abord de se débarrasser de la forêt. La toponymie en témoigne : de nombreux villages walser ont été fondés en plein bois. Avant 1244, une dizaine de famille de Walser ont reçu la concession de deux alpages situés dans une vallée latérale de la Valle Magia, Sant’Abondio et Quarino. Ils ont établi leur village dans le « bois de Quarino », qui se trouvait en-dessous de cet alpage. Ils en ont eu raison en peu d’années, et en 1253, Bosco Gurin recevait son église paroissiale. C’est aujourd’hui la commune la plus élevée du canton du Tessin. De même, avant que les colons valaisans n’installent les premiers habitats permanents en Val Formazza, cette haute vallée était une voie de passage et sans doute une station intermédiaire pour les troupeaux des habitants de la vallée d’Antigorio. Au moment de leur arrivée elle était boisée, comme en témoigne encore aujourd’hui le nom walser de certains hameaux, comme Frütwald, Tuffwald, Stafelwald, ou tout simplement Wald34. La présence de la forêt est une difficulté, mais aussi un atout pour l’établissement des colons : les fûts des grands conifères fournissent le bois de construction nécessaire à l’édification du village. Le taillis, brûlé sur place, enrichit le sol et assure la qualité des premières récoltes.
43Les Walser n’ont pas toujours formé des colonies autonomes. Tout au contraire, ils se sont fréquemment mêlés aux populations autochtones, sans trop de conflits semble-t-il. Lorsque conflit il y a eu, c’est à propos des alpages. Nous avons vu que celui de Rondo, en Valsesia, était exploité dès l’an Mil et sans doute auparavant. En 1256, les chanoines de San Giulio d’Orta en concèdent les deux tiers à un consortage de douze colons Valaisans. Les hommes de Varallo et d’Omegna, qui inalpaient depuis longtemps sur ces pâturages sans autre droit que coutumier, tentent évidemment de s’y opposer. C’est bien en vain, car en 1270 la concession de 1256 est confirmée par le chapitre de San Giulio35. En revanche, il est rare que les autochtones aient disputé aux Walser les lieux inhospitaliers où ils installaient leurs habitats permanents. Assez représentative est la partition qui s’est organisée dans la vallée du Prättigau, où les colons valaisans ont été appelés par les prémontrés du prieuré de Klosters : laissant le fond de cette vallée aux populations d’origine romane dont le dynamisme naturel suffisait bien à en assurer l’exploitation intensive, les Walser ont colonisé les versants et les vallées latérales, fondant les villages de St. Antönien, Schlappin, etc.36.
44Tel est donc, en dernière analyse, l’acquis des xiiie et xive siècles dans les Alpes centrales et septentrionales : achèvement de la mise en valeur des fonds de vallées glaciaires en auge et conquête des versants, ainsi que des vallées latérales. La vallée de Chamonix en offre un exemple représentatif37. Morphologiquement, il s’agit d’un synclinal qui sépare le massif du Mont-Blanc de celui des Aiguilles rouges. Il a été remodelé par les glaciers, qui lui ont donné sa forme typique en auge. À l’exception de leur commune raideur, tout oppose les deux versants de la vallée. Le massif du Mont-Blanc, qui culmine comme chacun sait à 4 810 m, présente de formidables réserves de neige et de glace qui, combinées à l’orientation nord-est – sud-ouest de la vallée, en font un ubac redoutable. Le versant des Aiguilles rouges, qui ne dépasse pas 2 900 m d’altitude, est relativement moins inhospitalier. Vers 1090, l’abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse reçoit la vallée en aumône du comte de Genève. À cette date, cette dernière, où l’on cultivait déjà des céréales au Néolithique, n’est certainement pas vide d’hommes. Mais les glaciers viennent seulement d’entamer un recul qui culminera au xiiie siècle à la faveur du petit optimum climatique. En sorte que les habitants, sans doute peu nombreux, ne peuvent être établis qu’en fond de vallée, inalpant en outre sur quelques pâturages de versant, dont certains, comme celui du Prarion, sont connus comme ayant été exploités de toute antiquité.
45Au cours du xiie siècle, ainsi qu’on l’a vu, les bénédictins de Saint-Michel-de-la-Cluse, fondent un prieuré à Chamonix. Ils établissent dans la vallée une seigneurie foncière et banale, c’est-à-dire qu’ils y revendiquent la possession du sol et l’exercice du pouvoir. Sur ce double fondement, ils organisent d’abord l’achèvement de la mise en valeur du fond de la vallée, où il restait alors des terres à essarter, notamment au pied de l’ubac, comme la toponymie en témoigne. Ce sont eux, probablement, qui partagent le terroir en manses ou, comme on dit plus volontiers dans les Alpes, en « mas ». À la fin du Moyen Âge, ce n’étaient plus que des circonscriptions fiscales dont les multiples tenanciers étaient collectivement solidaires du paiement des redevances. Mais à l’origine, il s’agissait peut-être de tenures familiales, car un patronyme leur est parfois resté attaché. À ces exploitations du fond de vallée étaient d’ailleurs associées des droits d’usage sur les alpages situés sur les épaulements des versants, principalement dans les Aiguilles rouges.
46Dans une seconde phase, c’est-à-dire à partir du xiiie siècle, les bénédictins organisent la mise en valeur des versants. Ils lancent les défricheurs à l’assaut de pentes parfois incroyablement abruptes, les encourageant à constituer des « essarts » (exerti) par brûlis et les autorisant à les pérenniser contre un cens modique. Le nom de certains de ces défricheurs est resté attaché à leur essart : ils avaient nom Jacques Cartier, Jean du Tour, Mermet et Brunier Pastor, Mermet Mossoux, etc. Les bénédictins lotissent des pans entiers du versant du Mont-Blanc en « prises » (preysie), c’est-à-dire en terres bonnes à prendre. Des familles ou des pareries entières s’y attaquent, accompagnant le recul des glaciers et la reconstitution des sols. C’est à cette phase qu’il faut probablement attribuer la création des plus élevés des alpages de l’ubac. En sorte qu’à la fin du Moyen Âge, les épaulements glaciaires des deux versants de la vallée sont presque tous transformés en alpages, tous ceux, du moins, qui pouvaient l’être. Ils le resteront d’ailleurs jusqu’au xxe siècle. En dessous des épaulements, la plus grande partie des versants est fauchée et pâturée. Des bois ont été conservés au-dessus des hameaux, pour les nécessités du chauffage, de la construction et de la prévention des avalanches. On trouve encore des portions de « bois noirs », c’est-à-dire des forêts de conifères, au niveau des alpages, car le bois est également nécessaire, comme on le verra, à l’exploitation pastorale. En sorte qu’on aboutit, en certains endroits, à un étagement végétal totalement artificiel, la forêt surmontant les prairies.
47Vers 1100, la vallée de Chamonix était entourée de montagnes qui étaient très largement le domaine de la nature sauvage ; vers 1350, elles sont profondément humanisées. Jamais, d’ailleurs, elles ne le seront davantage. Quel a été le rôle des bénédictins de Chamonix dans une transformation si profonde ? Il n’est pas interdit de les imaginer, surtout dans les premiers temps de leur installation, en « moines défricheurs ». Mais comment auraient-ils suffi à la tâche, les effectifs du prieuré n’ayant certainement jamais dépassé la douzaine de religieux ? Comme ailleurs, leur rôle a principalement été d’encadrement, d’encouragement, d’organisation. C’est le prieur de Chamonix qui a installé, en 1264, une colonie de Walser dans la vallée adjacente de Vallorcine, la partie plus excentrée et la moins hospitalière de ses possessions. Cela ne semble avoir suscité aucune protestation, alors qu’à la même date, certains alpages du mandement font déjà l’objet d’une vive concurrence entre communautés villageoises. Cela confirme l’idée que les alpages ont été soumis plus précocement que les vallées à une exploitation intensive. Pour ce qui est de la vallée de Chamonix proprement dite, la main-d’œuvre nécessaire à sa mise en valeur a été fournie par l’apport conjoint de la croissance naturelle de la population autochtone et de colons extérieurs dont on ignore l’origine, ceux-ci paraissant en bon accord avec celle-là : en 1292, les premières franchises de Chamonix permettent aux habitants d’associer à leurs tenures des « colons partiaires ». Cela suppose qu’il y avait encore des terres à prendre, et des profits à tirer, pour les habitants, d’une sous-inféodation partielle de leurs exploitations.
48On voit que dans les Alpes centrales et septentrionales, la conquête de la montagne a été un phénomène spectaculaire dans ses aboutissements mais extrêmement progressif, qui s’est poursuivi, comme dans les régions méridionales, jusqu’aux premières décennies du xive siècle. Comme dans ces régions également, les pentes intermédiaires ont été mises en valeur après les fonds de vallées et les pâturages d’altitude. Les Alpes du nord sont plus tardivement éclairées par les sources que celles du midi, et ce phénomène documentaire correspond probablement à une réalité : il semble bien que la conquête systématique des Alpes centrales et septentrionales ait commencé plus tardivement que celle de la zone méditerranéenne. C’est pourquoi les communautés religieuses ont pu y trouver fort tard des « solitudes » où s’installer, rencontrant moins d’opposition qu’ailleurs ; c’est pourquoi les entreprises de défrichements ont fait appel à une main-d’œuvre étrangère aux hautes vallées. À la veille de la grande peste en tout cas, le rattrapage était assuré.
Stabilisation
49Défrichements et croissance démographique ont partie liée, se combinant habituellement en une « spirale vertueuse » bien connue des historiens du Moyen Âge central. La natalité favorise doublement les défrichements : car c’est pour nourrir les enfants qui leur sont nés que les paysans se lancent à l’assaut de la friche ; et devenus adultes, ces enfants sont autant de nouveaux essarteurs. En sens inverse, l’augmentation de la surface agricole soutient la natalité, en permettant de nourrir correctement les bouches supplémentaires. En sorte qu’en Europe occidentale, croissance démographique et économique sont allées de conserve entre le xe et le xiiie siècle. L’augmentation de la population n’a pas empêché une élévation générale du niveau de vie, mise en évidence par les découvertes de l’archéologie : pour le dire en deux mots, le paysan de l’an Mil vit dans une cabane, celui de 1300 habite une maison. Par ailleurs il détient souvent, face à son seigneur, des garanties que ses ancêtres n’avaient pas. Mais le mécanisme s’enraye dès les dernières décennies du xiiie siècle, car la terre à défricher commence à manquer, alors que la natalité continue sur sa lancée. Au commencement du xive siècle, l’Europe occidentale est devenue « un monde plein », selon l’expression qu’on doit à Pierre Chaunu, et les paysans s’entassent sur des exploitations de plus en plus morcelées, qui ne leur fournissent plus que le strict nécessaire. Si bien qu’après 1310 une succession d’années pluvieuses amène le retour de la famine en Europe septentrionale, et de la disette dans les régions méditerranéennes. Ce sont donc des populations européennes fragilisées qui seront frappées par la grande peste de 1348, laquelle marque le commencement d’un nouveau cycle. Quelle est la place des Alpes dans ce contexte général ?
Bilan démographique de la grande croissance
50La première chose qui frappe est un certain décalage chronologique par rapport à la séquence communément reçue par l’historiographie médiévale : commencés après ceux des grandes plaines agricoles d’Europe occidentale, les grands défrichements alpins se sont sans aucun doute poursuivis plus tardivement : nous avons vu qu’en bien des endroits ils ne sont pas encore achevés au commencement du xive siècle.
51Là où des données sont disponibles, on voit que comme partout, les défrichements se sont appuyés sur une natalité dynamique. Interrogés en 1260 par les enquêteurs delphinaux, les habitants des sept paroisses du Queyras affirment : « Si un homme du lieu a trois ou quatre fils ou filles, plus ou moins, qui construisent des maisons dans le chosal ou le courtil paternel pour les habiter, chaque enfant doit au comte, comme cens, une poule ou un chapon ». Il semble donc que ce soit chose normal, pour un Queyrassin de la mi-xiiie siècle, d’avoir trois ou quatre enfants qui parviennent à l’âge adulte, ce qui suppose évidemment beaucoup plus de naissances. Comme on ne peut pas diviser les exploitations en trois ou quatre à chaque génération sans aboutir rapidement à une misère généralisée, les défrichements ont représenté un nécessaire exutoire. Celui-ci semble avoir fonctionné assez tardivement, car en Queyras comme dans le mandement voisin de Césanne, ou encore dans le bourg de Briançon, la population augmente de 45 % environ entre 1265 et 1339. Les Bauges présentent une physionomie comparable, avec, sauf effet de sources, une croissance de 25 % entre 1325 et 134738, ce qui semble aller de pair avec des défrichements encore très actifs vers 1340.
52Mais en ce domaine, chaque vallée présente sa physionomie propre : en effet, le Valcluson, tout proche du Queyras, ne voit sa population augmenter que de 8 % entre 1265 et 1339. Plusieurs indices, notamment toponymiques,laissent entendre que la mise en valeur de cette vallée est plus ancienne que celle du Queyras39. À la fin du xiiie siècle, il n’y restait donc plus guère de terres à conquérir. Si la natalité y était encore forte, ce qui est probable, le seul débouché était l’émigration. Le Valcluson ne représente pas un cas isolé. Dans les hautes vallées piémontaises, le commencement du xive siècle correspond généralement à des difficultés économiques et à une stagnation, voire une régression de la population40. Dans les vallées de Haute-Provence, dont nous savons également qu’elles furent très anciennement occupées, les difficultés sont encore plus précoces : en Vésubie, la population stagne entre 1264 et 129741.
53Au commencement du xive siècle, les sources exploitables par les historiens démographes sont d’origine fiscale : ce sont des listes de « feux », c’est-à-dire de foyers fiscaux. C’est donc d’abord en ces termes qu’il faut exprimer les densités. Dans le massif du Mont-Blanc, on trouve environ cinq feux/km2 au début du xive siècle, ce qui correspond à ce qu’on constate en Chartreuse42. Dans la haute vallée de Suse, on tombe à trois ou quatre feux/km2, et même à deux ou trois dans les paroisses montagnardes du Valais occidental, ainsi qu’en Queyras et en Briançonnais. Pierre Dubuis a pu ainsi opposer « une vaste zone alpine relativement sèche » allant du haut Dauphiné au Valais, à des montagnes mieux arrosées et pouvant supporter des densités plus élevées43. Cela recoupe approximativement l’opposition entre montagnes « à vaches » et montagnes moutonnières, même si celle-ci doit être nuancée, comme on verra. À première vue, ces densités ne paraissent pas dramatiquement fortes. À la même époque, le royaume de France supporte neuf à vingt feux/km2 au nord de la Loire, et cinq à huit dans les régions méditerranéennes.
54Mais si l’on rapporte les densités à la seule surface agricole utile, il faut déduire de la superficie des paroisses montagnardes les étendues rocheuses et glaciaires. On a pu le faire pour le Valais occidental et le massif du Mont-Blanc où l’on calcule alors respectivement des densités de 6 et 10 feux/km2. En fait, si l’on considère que les feux du commencement du xive siècle hébergeaient quatre ou cinq personnes en moyenne, ce qui semble une estimation raisonnable, on constate qu’au commencement du xive siècle, les hautes vallées des Alpes occidentales connaissaient des densités à peu près égales à celles du commencement du xixe, c’est-à-dire au maximum démographique jamais atteint avant la révolution touristique. Encore les montagnards du xixe siècle bénéficiaient-ils de la précieuse pomme de terre qui, à surface d’emblavure égale, permet de nourrir beaucoup plus de bouches que les céréales connues au Moyen Âge. On peut donc souscrire au jugement d’Alfred Fierro, pionnier de l’histoire démographique des Alpes médiévales, qui concluait, pour la fin des années 1330, à « une effrayante surpopulation44 ». Les populations montagnardes se nourrissent alors avec difficulté. C’est en cet état qu’elles sont frappées par le plus terrible accident démographique du Moyen Âge, la pandémie européenne de peste qui, remontant depuis la Méditerranée, touche les Alpes en 1348-1349. Les conséquences en sont catastrophiques. Partout où des études sont disponibles, en Valais, Faucigny, Maurienne, Piémont, Haute-Provence etc., on constate que la « grande peste » et sa première récurrence de 1360 ont tué à elles deux entre le tiers et la moitié de la population45. La peste va d’ailleurs revenir régulièrement jusqu’à la fin du Moyen Âge, en sorte qu’à la surpopulation succèdera un siècle au moins de stagnation démographique.
55Mais il nous faut d’abord voir comment, dans le contexte de surpression démographique d’avant 1348, les alpages, qui représentaient un enjeu vital pour les communautés paysannes, ont fait l’objet d’une concurrence de plus en plus acharnée.
La guerre de tous contre tous
56La période 1250-1350 correspond en effet à la fin d’une époque, d’une très longue époque qui avait commencé au Néolithique : celle où l’exploitation pastorale de la montagne était pratiquée de manière extensive, par des éleveurs dont la présence de fait sur l’alpe n’avait nul besoin d’être fondée en droit, parce que chacun y trouvait alors sa place sans difficulté. En Suisse centrale, les archéologues ont réussi à mettre en évidence cette mutation. Dans l’actuel canton de Schwyz par exemple, on a relevé 294 sites pastoraux abandonnés, dont les deux tiers sont situés au-dessus de 1 500 m d’altitude. 65 sont datés à coup sûr du Moyen Âge, 145 sont plus récents, la datation des autres étant incertaine. Les stations pastorales antérieures au xive siècle sont particulièrement sommaires. Selon toute apparence, ce sont des fondations « sauvages », c’est-à-dire sans titre de propriété ni contrôle d’une quelconque autorité seigneuriale. Elles correspondent à une exploitation pastorale fondée sur le petit bétail, largement associée à la chasse, extensive et même semi-nomade, les sites étant délaissés lorsque les prairies ont tendance à s’épuiser. Ainsi de la bergerie de Spilblätz ; établie autour de l’an Mil sur la Charetalp, à 2 100 m d’altitude, elle servait à l’estivage d’ovins et de bovins, mais aussi à la chasse. Elle fut définitivement abandonnée vers 1400, ce qui reflète une mutation séculaire intervenue sur la Charetalp comme dans toute la Suisse centrale. Entre 1200 et 1350 en effet, l’exploitation pastorale devient plus intensive, c’est-à-dire qu’on achève de défricher les alpages, que les stations pastorales deviennent permanentes, et qu’on se livre dorénavant à une véritable culture de l’herbe, en lien avec un progrès de l’élevage bovin46. Deux phénomènes, concomitants et inséparablement liés, en sont la cause : le nouvel intérêt des seigneurs laïcs et ecclésiastiques pour les espaces pastoraux, et la croissance démographique dans les hautes vallées.
57La documentation écrite reflète également cette évolution, en ce sens qu’elle atteste de conflits pastoraux de plus en plus nombreux, signes d’une surexploitation croissante des alpages. Et d’abord, les conflits entre communautés paysannes et monastères, qui sont, comme on sait, presque aussi anciens que la présence de ces derniers dans les hautes vallées, prennent une ampleur nouvelle. Nulle part ils n’ont été plus violents qu’en Suisse centrale47. Là en effet, les communautés d’Uri et de Schwyz, fortes de privilèges qui leur accordaient l’immédiateté impériale ainsi qu’une large autonomie juridique, fortes aussi de leur union consacrée par le célèbre pacte de 1291, crurent possible, à la fin du xiiie siècle, de se débarrasser définitivement de leurs principales concurrentes en matière pastorale, les puissantes abbayes voisines d’Engelberg et d’Einsiedeln, dont les Habsbourg eux-mêmes étaient les avoués. Le pagus d’Uri, abrupt et étroit, manque de bons pâturages. Aussi les Uranais ont-ils très tôt étendu leurs domaines pastoraux aux dépends de leurs voisins. À l’est, ils ont franchi le col du Klausen et ont fait paître leur bétail en amont de la vallée glaronaise de la Linth. Mais dès la fin du xiie siècle ils se sont heurtés aux hommes de Glaris. Aussi se sont-ils implantés à l’ouest, au-delà du col des Surènes, sur des pâturages revendiqués aussi par le monastère des bénédictins d’Engelberg. Les premières bagarres entre les bergers d’Engelberg et ceux d’Uri sont attestées en 1260, mais le conflit est certainement plus ancien. Il s’envenime dangereusement dans les années qui suivent. C’est en vain qu’en 1273 la reine Gertrude, épouse du roi des Romains Rodolphe de Habsbourg, avoué du monastère, prend la défense des religieux, en vain qu’en 1275 un arrêt du juge royal limite le droit de pâture des gens d’Uri. Ceux-ci ont dorénavant recours à la violence. Des interventions répétées du roi Albert Ier de Habsbourg, de sa femme la reine Élisabeth, de sa fille Agnès, veuve du roi de Hongrie, du pape Clément V lui-même, ne parviennent pas à mettre fin à la pression qu’ils exercent sur le monastère. Après l’assassinat d’Albert Ier en 1308, les bénédictins perdent leur protecteur. Au printemps 1309, les Uranais saccagent l’église abbatiale, manquent de pénétrer dans les bâtiments monastiques, et repartent avec le bétail de l’abbaye. Le 25 juin, la médiation de notables de Schwyz et d’Unterwald aboutit à un partage des pâturages disputés favorable à la communauté d’Uri.
58L’affrontement entre la communauté de Schwyz d’une part et de l’autre les bénédictins d’Einsiedeln et leurs dépendants est particulièrement célèbre, parce qu’il est à l’origine de l’avènement des Suisses comme puissance politique et militaire à l’échelle européenne. L’objet principal de ce « Marchenstreit » est le contrôle de la haute vallée de la Sihl. Au xiie siècle, les défricheurs schwyzois et ceux d’Einsiedeln s’y affrontent déjà, au point que l’empereur doit intervenir en 1114 et 1143. Entre 1214 et 1217, trois années de véritable guérilla s’achèvent par un arbitrage en faveur des Schwyzois, rendu par le comte de Habsbourg Rodolphe l’Ancien. Mais les incidents se multiplient, qui ne concernent pas que la question pastorale : les Schwyzois veulent en fait soumettre les diverses communautés religieuses de leur pagus à leur souveraineté. En 1294, le Landsgemeinde – assemblée populaire – de Schwyz interdit toute cession d’immeubles aux communautés religieuses, et astreint celles-ci au paiement de l’impôt communautaire. En 1308, l’abbé d’Einsiedeln se plaint à Albert Ier que les habitants de Schwyz multiplient les exactions et qu’ils ne paient plus les redevances pour les pâturages que le monastère leur a concédés à ferme. En 1309, il obtient de l’évêque de Constance qu’il jette l’interdit ecclésiastique sur les Schwyzois. Ceux-ci font appel au pape Clément V, qui lève l’interdit l’année suivante. Comme ils ne relâchent pas leur pression, bien au contraire, les moines recourent à l’empereur Henri VII de Luxembourg, qui tient une cour à Zurich en 1312. Ils n’ont pas moins de quarante-six doléances à lui soumettre : les Schwyzois ont occupé indûment prairies et pâturages, ils ont violé les réserves de chasse et de pêche du monastère, ils ont volé du foin, du matériel et du bétail, ils ont mis à sac des maisons d’habitation, ils ont été jusqu’à piller des églises et, au pied de l’autel, à s’enivrer du vin de messe. Henri VII n’a pas les moyens d’intervenir dans ces montagnes reculées. Dans la nuit des Rois de 1314, les Schwyzois, sous les ordres du Landammann Werner Staufacher, donnent l’assaut au monastère lui-même, pillent son église… et ses caves et, là encore, fêtent leur victoire par une mémorable beuverie. L’abbé s’enfuit, mais les moines, les serviteurs et le bétail du couvent sont emmenés prisonniers, avec un considérable butin. Les Schwyzois sont excommuniés à nouveau, ainsi que leurs alliés d’Uri et d’Unterwald. L’année suivante, le duc Léopold de Habsbourg se décide enfin à intervenir militairement pour les ramener à la raison. Mais le 15 novembre 1315, son armée est écrasée au défilé de Morgarten. C’est le début de l’aventure européenne des Suisses qui, invaincus pendant deux siècles, ne trouveront leur maître qu’à la bataille de Marignan. C’est également le commencement d’une construction politique sur laquelle nous reviendrons.
59Sans avoir des conséquences géopolitiques aussi grandes, des violences comparables sont attestées au même moment dans les Alpes méridionales. En juillet 1278, quatre-vingt paroissiens de Savines, en Embrunais, attaquent le troupeau des brebis de l’abbaye de Boscodon, alors qu’il paissait sur l’alpage de Martin Jean, qui était l’objet d’une contestation ancienne. Sous la direction de deux de leurs syndics, ils brutalisent les convers qui gardaient le troupeau, dispersent les bêtes, s’emparent de cinq des plus belles avec leur « sonnailles », les abattent et les mangent. De même, en 1333, les hommes de Roquebillière, en Vésubie, s’emparent de seize moutons à la faveur de plusieurs expéditions nocturnes contre le troupeau des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et les consomment aussitôt. En 1342, ils récidivent au détriment de l’Hôpital du Var, auquel ils soustraient trois brebis et un agneau, qui sont incontinent dévorés. Il faut noter que les paysans n’ont pas toujours l’initiative des violences. En 1278, ce sont les chartreux de Durbon qui attaquent le troupeau des hommes de Saint-Julien-Beauchêne sur l’alpage de Rioufroid. Devant l’official de Valence, les syndics de Saint-Julien affirment : « Le prieur est venu avec vingt frères de ladite maison, armés de bâtons. Plein d’intentions belliqueuses ils se sont jetés sur nous et nous ont frappés, nous et nos troupeaux. » En 1300 en revanche, les mêmes chartreux sont obligés de se défendre contre « presque toute l’université » d’Agnielles, femmes comprises, montée en armes aux pâturages du Recours. Là, les paysans s’emparent du bétail de la chartreuse et l’emmènent en le rouant de coups. Ils s’en prennent aux convers et aux moines qui étaient présents, blessant gravement certains d’entre eux. Ils entrent ensuite de force dans la grange des chartreux. À un frère qui leur ordonne de sortir ils répondent : « Nous ne t’obéirons pas plus qu’à un âne. » Ils s’emparent du bétail présent dans la grange et l’emmènent à Montmaur, tuant une vache au passage. Il est plus rare, dans les Alpes méridionales, que les agresseurs osent s’en prendre au monastère même. Un jour de 1338 pourtant, des paroissiens d’Arvillard font irruption dans l’abbatiale de la chartreuse de Saint-Hugon, avec le projet d’intimider les moines à qui ils disputent la jouissance de l’alpe du Collet48.
60On aurait tort de croire que les conflits d’alpages opposent seulement paysans et religieux. Au tournant des xiiie et xive siècles c’est, sur l’alpe, la guerre de tous contre tous. Les communautés religieuses elles-mêmes sont en concurrence, même si cela n’aboutit pas à des affrontements violents : en 1308-1310, c’est à coup d’eau bénite ou par des jets de pierres symboliques que les chartreux de Vallon tentent de chasser les cisterciens d’Aulps d’une combe chablaisienne contestée entre les deux monastères49. Mais on se bat surtout entre laïcs. En Vésubie par exemple, la situation est de plus en plus tendue dans les premières décennies du xive siècle. Ce sont d’abord d’innombrables contestations entre particuliers, que les communautés tentent de prévenir par un important effort réglementaire. Roquebillière édicte ainsi un règlement de pâture en 1306, Saint-Martin en 1311 et à nouveau en 1325, Utelle en 1333, 1340 et 1342, etc. Mais les affrontements entre communautés se multiplient tout aussi bien : trois conflits sont attestés en Vésubie entre 1287 et 1317, quatorze de 1320 à 1346. Comme leur durée s’allonge à mesure qu’on avance dans le xive siècle, on peut considérer que la guérilla d’alpage devient chronique : en 1323, les hommes de La Bollène lancent une expédition contre les troupeaux de Belvédère, en 1338, ce sont les habitants de Roquebillière qui confisquent le bétail de Lantosque, etc. À chaque fois, des animaux sont mangés50.
61On voit que ces affrontements ont un déroulement très stéréotypé, voire quasi rituel. La confiscation du bétail est une pratique systématique. C’est ce qu’on appelle « moutonner l’aver » en Provence, et plus au nord « pignorer le bétail ». L’enlèvement est presque toujours suivi d’une consommation collective. C’est un véritable rite qui manifeste la solidarité de la communauté contre l’adversaire commun : tous ceux qui ont mangé du bétail pignoré sont engagés par l’action menée. Les bâtiments d’alpage et les outils qu’ils contiennent font également l’objet de confiscations. En 1338, les hommes du Monêtier-de-Briançon s’attaquent aux chalets des gens de Villar-d’Arêne sur la montagne d’Arsine, y pénètrent par effraction, en confisquent les ustensiles métalliques ainsi que les bêtes, qui sont tuées, écorchées et salées. En 1356, les paroissiens de Livet, dans la vallée de la Romanche, s’attaquent à la montagne des Prés et y détruisent l’arcelle du seigneur de Séchilienne. Parfois directement attaqués dans leurs propres intérêts, les seigneurs sont également appelés au secours par leurs dépendants, dont ils sont les protecteurs naturels. Les contestations pastorales peuvent alors se transformer en guerres privées, avec mort d’hommes, surtout s’ils entrent en résonance avec des conflits régionaux. La paroisse de Salvan, en Valais occidental, dépend de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, dont le comte de Savoie est l’avoué. En 1323, les Salvanins enlèvent et séquestrent des bêtes appartenant à la communauté de Charousse, sujette du comte de Genève. Mermet de Thoire, un noble de Charousse dont plusieurs bêtes ont été saisies, lance une expédition punitive, avec l’aide de nombreux roturiers et nobles de Charousse, mais aussi des mandements voisins de Montjoie et Saint-Michel-du-Lac. C’est que ces châtellenies dépendent du sire de Faucigny, qui est alors allié au comte de Genève contre le comte de Savoie. La chevauchée tourne mal. Les agresseurs incendient plusieurs maisons de Salvan, mais parvenus à l’alpage d’Émosson, ils tombent dans une embuscade. Plusieurs sont tués, les autres sont faits prisonniers et livrés par l’abbé de Saint-Maurice au comte de Savoie, qui les emprisonne dans son château de Chillon51.
62Ajouter encore des exemples serait lassant, mais il est clair qu’au tournant des xiiie et xive siècles on se bouscule, à tous les sens du terme, sur les pâturages alpins. Ceux-ci ne peuvent pas rester plus longtemps les zones de non-droit qu’ils ont été depuis des millénaires.
Régularisation
63Parallèlement à la multiplication des conflits, et dans le but évident de les limiter, on assiste à un processus régularisation des rapports entre les différents usagers des alpages. Les communautés édictent, comme on l’a vu, des règlements de pâture à usage interne, afin de limiter les contestations entre particuliers. Les consortages de pasteurs du Cadore se sont ainsi qualifiées eux-mêmes de Regole, par allusion aux règles qui les régissaient et qui, bien que purement orales dans un premier temps, s’imposaient à tous leurs membres. Par ailleurs, les communautés transigent avec leurs voisines et concurrentes, afin de fixer les limites de leurs parcours de pâture respectifs. En 1237 par exemple, les Regole de Vinigo et de Falzàrego se partagent les pâturages de la Val Travenanzes, à raison d’un quart pour Falzàrego, le reste à Vinigo. Il est prévu que si un enneigement excessif empêche les troupeaux de Vinigo de redescendre dans la vallée en empruntant leur itinéraire habituel, ils pourront passer par le territoire de Falzàrego52. Les procédures de délimitation sont fréquemment supervisées et sanctionnées par des arbitres choisis d’un commun accord, et de plus en plus souvent imposées par l’autorité seigneuriale ou princière. Elles sont suivies de la rédaction d’actes écrits, soigneusement conservés par les communautés, et se concluent par la pose de bornes. Lorsqu’en 1347 les deux communautés briançonnaises du Monêtier et de La Salle s’opposent une nouvelle fois à propos des droits de pâturage et de bûcheronnage exercés dans les montagnes, l’archevêque de Lyon, lieutenant du dauphin alors absent outre-mer, constitue une commission pour régler le problème. Cette instance arbitrale se compose du juge et du procureur fiscal du Briançonnais, et de huit autres personnages de moindre envergure mais appartenant tous au milieu local. Le 19 juin, les arbitres se réunissent au village des Guibertes, en présence des syndics des deux bords. Ils proposent l’établissement de nouvelles limites, de chaque côté desquelles chacune des deux communautés devra désormais exercer et faire respecter ses droits. Le 8 juillet, les hommes du Monêtier, réunis en assemblée dans leur cimetière paroissial, ratifient l’accord à main levée, ce dont trois notaires dressent procès-verbal. Le 25 juillet, ceux de La Salle font de même. Le même jour enfin, en présence du mistral, c’est-à-dire du représentant du dauphin sur place, les nommés Jean Rabio, du village du Bez, et Barthélémy Roux-Brun, des Guibertes, procèdent à la pose des bornes séparant désormais le Monêtier de La Salle53.
64Mais les communautés ont surtout cherché à se faire garantir par leurs seigneurs un libre accès à leurs pâturages. Cela passe parfois par une charte de franchises. Dans celle qu’il accorde en 1310 à la communauté valdotaine d’Étroubles, Amédée V de Savoie reconnaît à ses habitants la jouissance de leurs pâturages et de leurs bois « ainsi qu’ils ont accoutumé de le faire jusqu’à présent ». En l’occurrence, il s’agit de la reconnaissance écrite d’un droit coutumier incontesté et incontestable. Mais il arrive que les franchises enregistrent un recul seigneurial. La charte accordée en 1269 à Mévouillon, dans les Baronnies dauphinoises, porte que Raymond, seigneur du lieu, s’interdit dorénavant de louer à des étrangers les pâturages de Mévouillon tant qu’ils seront nécessaires à la communauté, sauf en cas de guerre54.
65En fait, la situation foncière sur l’alpe est le plus souvent extrêmement embrouillée, et les droits des différents intervenants fort mal définis. Le cas de la Vésubie, en Haute-Provence, est spécialement bien éclairé par les inventaires des droits seigneuriaux de Charles d’Anjou, comte de Provence et roi de Naples, ainsi que par les riches et précoces archives des communautés villageoises55. Dans la deuxième moitié du xiiie siècle, le principal propriétaire d’alpages y est le comte, lequel possède notamment les quelques 6 000 ha de pâturages des alpes de Belvédère. Ensuite viennent les établissements religieux qui, comme nous l’avons vu, se sont implantés depuis le xie siècle : l’abbaye Saint-Pons de Nice et son prieuré de Saint-Dalmas-de-Valdeblore, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l’Hôpital du Var, le chapitre cathédral de Nice, l’église Notre-Dame de Fenestres. Enfin, quelques seigneurs laïcs, vassaux du comte, sont également possessionnés en Vésubie : les Vintimille, les Rostaing, les Tornaforti, etc. Les exemples de coseigneurie ne sont pas rares : les pâturages de Vénanson et de Saint-Martin sont détenus en indivision par le comte, les Vintimille et l’église Notre-Dame de Fenestres. Le comte de Provence a abandonné l’exploitation directe de ses pâturages ; en revanche, les autres seigneurs ont encore des troupeaux en Vésubie. Ceux des monastères paissent d’ailleurs en partie sur les pâturages comtaux. Les paysans du lieu n’apparaissent qu’au tout dernier rang des propriétaires fonciers : l’enquête de 1252 signale seulement quelques pâturages « tenus » par les hommes de Lantosque et de Belvédère. Les seigneurs leur louent certains pâturages pour l’été ou, pour reprendre la terminologie provençale, leur en vendent l’herbe. Mais leurs troupeaux sont alors en concurrence avec ceux des éleveurs qui transhument depuis la basse Provence.
66Au premier abord, la situation des communautés rurales de la Vésubie ne paraît donc guère enviable. Mais il faut compter avec leurs « libertés », c’est-à-dire avec les droits d’usages qu’elles possèdent sur les pâturages seigneuriaux, et principalement sur ceux du comte. Ces droits apparaissent dans la documentation écrite lorsqu’ils sont contestés, soit que deux communautés se les disputent, soit qu’un seigneur tente de les remettre en cause. Entre les décennies 1280 et 1330, diverses sentences arbitrales mettant fin à des conflits entre communautés villageoises permettent de se rendre compte à quoi correspondent concrètement leurs droits d’usage : nous voyons les communautés paître leurs troupeaux sur les alpages seigneuriaux, y couper du bois, y construire des « cabanes » et des enclos à moutons, mettre certains bois et pâturages en défens et commettre des « campiers » pour les garder, autoriser ou interdire la montée du bétail étranger. Si ces textes ne réservaient expressément les droits des seigneurs, on aurait l’impression que les paysans sont véritablement propriétaires de ces alpages. C’est d’ailleurs le sentiment qu’ils ont. En 1329, l’administration comtale diligente une enquête contre les hommes des paroisses de Saint-Dalmas et Saint-Martin, sommés de prouver qu’ils ont un titre à occuper les pâturages comtaux. Ces communautés présentent des témoins qui affirment que « depuis dix, vingt, trente et quarante ans déjà écoulés et tant de temps que la mémoire du contraire ne se manifeste pas », elles avaient de ces pâturages une possessio pacifica seu quasi. Lorsqu’on demande aux témoins ce qu’ils entendent par là, ils répondent que c’est le fait que « quelqu’un possède quelque chose pendant plusieurs années, dix, vingt et trente et ainsi pour chacune, sans aucune contradiction ».
67Au xive siècle, tout l’effort des communautés paysannes consiste à transformer une possession de fait en propriété consacrée par le droit. Et de fait, en un peu plus d’un siècle, leur obstination vient presque entièrement à bout de la présence seigneuriale sur les pâturages de la Vésubie, par tous les moyens, légaux et illégaux. En 1356 par exemple, Louis et Jeanne d’Anjou inféodent à Rainier de Tende, de la famille des Vintimille, une rente annuelle de 65 florins à prendre sur les revenus qu’ils perçoivent dans le territoire de Madoinas. C’est un cadeau empoisonné, car la communauté de la paroisse d’Utelle affirme aussitôt avoir sur ce territoire des droits aussi immémoriaux que gratuits. En 1360, Rainier pense en venir à bout avec l’aide du prince, à qui il réclame confirmation de sa donation, se plaignant que son fief ne lui rapporte pas la moitié de ce qu’il est en droit d’en attendre. Mais en 1369 il comprend qu’il ne viendra pas à bout de la résistance paysanne, et entreprend de vendre son fief au plus offrant, au prix minimum de 600 florins. Nul n’osant surenchérir sur les Utellois, c’est à ce prix que la communauté l’acquiert. Les monastères n’ont guère mieux résisté que les seigneurs laïcs. Il faut dire que l’administration comtale a plutôt pris le parti des paysans. Lorsque les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et l’Hôpital du Var portent plainte après les violences paysannes que nous avons rapportées plus haut, ils ne sont guère soutenus par la justice comtale. En 1342 par exemple, les paysans nient en bloc, et comme on ne trouve aucun témoin pour oser rompre l’omerta, elle renonce à poursuivre. Surtout, en 1345, la chambre des comptes de Provence interdit à quiconque d’introduire du bétail « dans quelque lieu du domaine royal » s’il n’y fait résidence habituellement. C’est, dit-elle, pour protéger les pâturages de la dévastation, et les habitants du lieu de la misère. L’herbe de la réserve comtale est donc dorénavant réservée aux communautés locales. L’Hôpital du Var fait appel de cette décision au nom de ses propres droits coutumiers, mais en vain : ses troupeaux ne pourront plus monter à Belvédère. En fait, certains des pâturages seigneuriaux de la Vésubie continueront d’être loués à des troupeaux étrangers, mais au profit exclusif des communautés paysannes. En 1317, cela faisait déjà une trentaine d’années que les hommes de Saint-Martin vendaient l’herbe du défens de Cereysa. Cette année-là, ils obtiennent que les seigneurs du lieu, les frères Tornaforti, renoncent à rien percevoir sur les profits que leur communauté en tire.
68Alliées au prince contre les établissements religieux, les communautés paysannes n’ont pourtant pas hésité à s’opposer à lui. Il faut dire que leurs droits d’usage sur les pâturages comtaux étaient si anciens, et que tant de témoins se proposaient à les établir, que les procédures intentées contre eux n’aboutissaient qu’à les consolider par une confirmation écrite. Saint-Dalmas et Saint-Martin ont ainsi tiré bénéfice de l’enquête menée à leur encontre en 1329. Il en va de même d’un procès intenté en 1334 à la communauté de Belvédère, accusée d’avoir étendu à l’excès certains de ses défens. Elle produit ses témoins, et le principal résultat de la procédure est que six défens lui sont maintenant confirmés par écrit. Outre les actions judiciaires, les communautés n’ont pas hésité à aller jusqu’à l’épreuve de force : en 1333 et 1341, le clavaire comtal ne parvient pas à vendre l’herbe les alpes de Belvédère : les communautés locales font la grève de l’alpage, et s’opposent à la montée de troupeaux étrangers. Après de nouveaux procès en 1353 et 1355, l’administration provençale semble se lasser de la lutte. Elle reconnaît d’abord la communauté de Belvédère comme fermier des alpes de ce nom. En 1395 enfin, elle les cède définitivement en emphytéose aux hommes de Belvédère et Lantosque, contre le cens annuel de 40 £, ainsi qu’une acapte de 225 florins, somme modique à l’égard de la surface des pâturages concédés. La même année, la communauté de Saint-Martin se fait accorder ce qu’il restait de droit comtaux sur ses pâturages contre un cens modique et sans aucune acapte, tant ces droits étaient devenus symboliques.
69Certes il s’en faut de beaucoup que tous les paysans aient obtenu une victoire aussi complète que ceux de la Vésubie, et nous verrons bientôt que nombre de communautés ont dû laisser une part de leurs pâturages à des troupeaux étrangers pour le plus grand profit leurs seigneurs. Mais les paysans ont dans l’ensemble obtenu une reconnaissance et souvent une mise par écrit de leurs droits d’usages sur les alpages. Les seigneurs y voyaient l’occasion d’une rentrée d’argent, à une époque où ils connaissaient souvent une situation financière difficile. Le prix que les communautés ont dû y mettre était inversement proportionnel à la solidité de leurs droits coutumiers et à la solidarité paysanne. Au tournant des xiiie et xive siècles, les sires de Faucigny soutiennent contre le comte de Savoie une guerre qui pèse lourdement sur leurs finances. Comme ils ont abandonné depuis longtemps toute exploitation pastorale directe et que les alpages de leur réserve ne voient plus monter que les troupeaux de leurs dépendants, ils n’ont aucun scrupule à les alberger aux communautés qui les occupent déjà. Celles-ci sont prêtes à payer cher pour se voir garantir la possession de leurs alpages, car elles sont fortement concurrentes les unes des autres. Si bien que lorsqu’en 1339 le dauphin Humbert II, successeur des Faucigny, fait enquêter sur les biens et les droits qu’il détient en vallée de l’Arve, il n’y possède plus que deux alpages. Les autres ont été albergés, à moins que les paysans n’y aient bénéficié de droits d’usages si incontestables qu’ils n’ont pas jugé nécessaire d’en obtenir la confirmation, et que l’administration delphinale elle-même ne les considérait plus comme faisant partie de la réserve. Mais en 1355, le comte de Savoie Amédée V s’empare, avec difficulté, du Faucigny. Ce n’est pas un souverain aussi débonnaire qu’Humbert II, et il n’a pas de cadeau à faire à des montagnards qu’il a comptés fort longtemps parmi ses ennemis. La vallée connaît alors un tour de vis fiscal, qui se manifeste notamment par la mise en cause des droits d’usages non garantis par une concession écrite. En 1357 par exemple, le comte exige 300 florins des habitants du mandement de Samoëns, en échange de l’engagement qu’il prend à leur égard de ne jamais « donner, vendre, alberger, inféoder, concéder ou aliéner de quelque manière que ce soit » les alpages de Fréterole, Cuidex, Chardonnières et Vigny, dans le massif du Giffre. Ces sortes de pratiques relèvent du chantage, et les seigneurs y sont en position de force, car malgré la crise démographique, la concurrence reste vive pour l’accès aux alpages. Nombreux en Faucigny sont ceux qui profitent de la situation, d’autant plus que leurs autres revenus seigneuriaux subissent alors une érosion sans remède. En 1418 par exemple, l’abbaye de Sixt, dans le même massif du Giffre, menace ruine et l’abbé n’a pas de quoi entreprendre les réparations nécessaires. Il s’avise alors que la communauté de Charousse a des vues sur la montagne de Sales, sur laquelle les hommes de Sixt inalpent depuis longtemps en échange de diverses redevances annuelles, mais sans acte de propriété écrit. Il fait jouer la concurrence entre les deux communautés, et alberge finalement la montagne aux hommes de Sixt, contre l’introge de 400 florins. L’acte porte en toutes lettres que les habitants de Sixt ont déboursé cette somme pour avoir l’assurance de ne pas être évincés par ceux de Charousse56.
70Il est vrai qu’au tournant des xiiie et xive siècles, la documentation nous montre bien davantage de paysans présents sur les alpages que dans la période précédente. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’y ont accédé qu’à ce moment-là, comme l’historiographie alpine ancienne l’a cru trop facilement. En réalité, ces textes montrent seulement que les paysans des hautes vallées alpines ont eu alors à batailler pour conserver le libre accès à leurs pâturages, dans un contexte marqué par la surexploitation pastorale, la naissance de l’État, l’essor du droit romain et l’importance que la justice accorde dorénavant aux preuves écrites.
71Ces conditions nouvelles ont également nécessité l’accession des communautés paysannes à une existence politique.
Notes
1 Bergier, 1984, p. 82.
2 Menant, 1993, p. 138-139, 149, 255-260. Guglielmotti, 1998.
3 Boyer, 1990/a, p. 60-61.
4 Sclafert, 1926, p. 1-59. Wullschleger, 1994.
5 Rotelli, 1973, p. 21-24. Comba, 1983. Id., 1984.
6 Comba et Dal Verme, 1996, p. 16-17, n. 22.
7 Mariotte, 1978.
8 Carrier, 2004, p. 227, n. 19 et 21.
9 Mouthon, 2001/c, p. 18-19.
10 Sclafert, 1926, p. 21-24.
11 Mouthon, 2001/c, p. 21-22.
12 Sclafert, 1926, p. 18-20.
13 Ibid., p. 33-34.
14 Wullschleger, 1986. Josserand, 1995. Chevalier, 1869, notamment les chartes 16, 43, 74, 190, 227, 260, 301.
15 Sclafert, 1926, p. 137.
16 Josserand, 1995, p. 19-22.
17 Sclafert, 1926, p. 45-46, 49.
18 Cité dans Sclafert, 1926, p. 254, n. 1.
19 Mouthon, 2007/b.
20 Cité dans Sclafert, 1926, p. 91.
21 Sclafert, 1926, p. 96-97.
22 Mouthon, 2005.
23 Falque-Vert, 1997, p. 216.
24 Castagneti et Varanini, 2004, p. 465-469
25 Voir en dernier lieu Rizzi, 1991 et Id. 2003-2005.
26 Cité dans Morard, 1984, n. 16 p. 25.
27 Dubuis, 1996/b. Rizzi,2003-2005, t. 2, p. 209-221
28 Carrier, 2001/a, p. 176-177.
29 Rizzi, 1991, doc. 183.
30 Duparc, 1964, p. 38, 54-55, 65-66.
31 Carrier, 2001/a, p. 176.
32 Rizzi, 1991, doc. 87 (Rimella), 149 (Bosco Gurin), 314 (Davos).
33 Rizzi, 1991, doc. 182 et 183.
34 Rizzi, 2003-2005, t. 2, p. 31-33 (Formazza), 51 (Bosco Gurin), 95 (Macugnaga), 161 (Gressoney).
35 Rizzi, 1991, doc. 87. Guglielmotti, 1998, p. 131-132, n. 25.
36 Rizzi, 2003-2005, t. 1 p. 196-197.
37 Carrier, 2001/a, p. 176-190.
38 Mouthon, 2009, p. 31.
39 Falque-Vert, 1997, p. 24-31.
40 Comba, 1977, p. 35-42.
41 Boyer, 1990/a, p. 443-444. Baratier, 1961,p. 78-81.
42 Mont-Blanc : Carrier, 2001/a, p. 60-65. Mouthon, 1996-1997, p. 20-21.
43 Dubuis, 1994, p. 49-66.
44 Fierro, 1971.
45 Aux travaux cités supra, ajouter notamment Gelting, 1991.
46 Auf der Maur, 1998. Werner, 1998.
47 Bergier, 1988, p. 198-200, 355-363, 368-376. Glauser, 1988, p. 50-55, 82-84.
48 Savines et Arvillard : Mouthon, 2001/b, p. 265. Roquebillière : Boyer, 1990/a, p. 66. Durbon : Sclafert, 1926, p. 113-114.
49 Carrier, 2003, p. 229-230.
50 Boyer, 1990/a, p. 65-75.
51 Carrier, 2001/a, p. 41-42.
52 Richebuono, 2001, p. 15-17.
53 Arch. dép. Hautes-Alpes, E 313.
54 Sclafert, 1926, p. 135-136.
55 Boyer, 1990/a, p. 64-79.
56 Carrier, 2001/a, p. 311-312. Carrier et La Corbière, 2005, p. XL-XLI.
© Presses universitaires de Rennes, 2010
Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540
